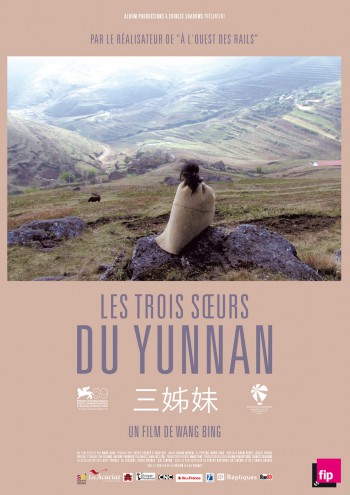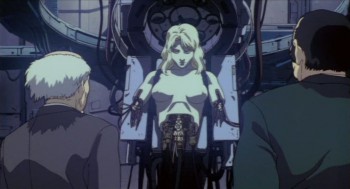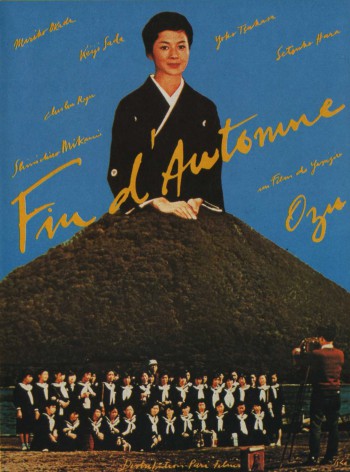La Traque
NORA INU - CHIEN ENRAGÉ (1949) – Akira Kurosawa

S'il est un auteur que Kurosawa n'a pas adapté, mais qu'il aurait aisément pu porter à l'écran, c'est bien Seicho Matsumoto, maître du roman noir dans la littérature japonaise. Les deux auteurs partagent en effet une même noirceur dans la description d'une société ou de personnages en proie à la tourmente et aux questionnements psychologiques. Chien enragé, l'un des premiers films de Kurosawa semble ainsi imprégné de la patte de Matsumoto, s'y retrouvant le goût pour les enquêtes dans un milieu rural, le parcours parmi les différentes strates de la société, ou encore la culpabilité de l'inspecteur. C'est cependant l'un des assistants réalisateurs de Kurosawa, Yoshitaro Nomura, qui adaptera nombre de romans de Matsumoto (Le Vase de sable, L'Eté du démon...)
Au-delà de ses magistrales films-fresques ou films historiques, Akira Kurosawa a également réalisé de magnifiques films noirs. Partageant quelques similitudes avec l'émouvant Ange Ivre (Yoidore Tenshi, 1948), auquel il succède, Chien enragé en est comme le miroir, l'opposé tout autant que le prolongement.

Après le monde des voyous, nous voici du côté du monde policier. Et pourtant, le portrait se révèle tout aussi désespéré, du moins tout autant torturé et complexe. Le récit s'attache en effet à un jeune policier se faisant bêtement dérober son arme de service dans un tramway bondé. Abattu par la honte du débutant, le jeune homme tente de retrouver son arme, angoissé à l'idée qu'elle ait pu servir à un braquage. Le postulat, simple de base, et éminemment réemprunté chez quelques grands admirateurs du cinéaste – le même principe est présent dans le Police Tactical Unit (2003) de Johnnie To – devient peu à peu celui d'une quête absurde. Très rapidement, les premières séquences impose le tableau, brosse à grands traits l'idée du vol de larme à feu dans le tramway. La disparition de l'arme, en elle-même absurde dans son événement, conduit vite à une quête désespérée, où la détresse du jeune policier débutant vient vite contaminer sa perception de l'environnement et de fait une réalisation sensible à ce changement d'état. Chien enragé capte très vite une réalité âpre, au plus près de la population des bas-fonds, du grouillement des villes et des quartiers. La captation de la réalité chez Kurosawa s'accompagne toujours d'une progressive décontamination : peu à peu les espaces se vident, se dépeuplent, les rues cèdent le pas aux paysages ou à la désolation. La perception d'un environnement riche devient progressivement un repli intérieur, d'où surgit un certain onirisme.

Chien enragé confirme cette capacité chez Kurosawa à obtenir un « jusqu'au boutisme » du drame, approfondissant l'enjeu pour le transformer en un sentiment fort et douloureux venant à déteindre sur le rythme, la composition, l'esthétique du film. Par exemple, la première séquence forte dans le scénario concerne celle d'une longue recherche de trafiquants d'armes dans les quartiers populaires. Pendant près de dix minutes, le son se débarrasse de tout dialogue pour capter, accompagné par une musique dramatique, les sons de la ville, là où le montage, enchaînant les fondus enchaînés, aligne les errances du policier. S'appuyant sur la répétition, cette séquence, plutôt audacieuse par son traitement de la durée, se laisse peu à peu empreindre du désespoir et de l'harassement du policier. Le rythme vacille, les repères se brouillent. Le film de Kurosawa se fait l'écho du mental meurtri de son protagoniste. La séquence finale – par ailleurs reprise en vibrant hommage par Satoshi Kon dans Paprika (2006) – s'inscrira elle-même comme un règlement de compte, non seulement avec le voleur, mais encore plus avec le policier lui-même, opposé face à son alter ego du même âge, et partageant une similaire rage. La traque urbaine du début reçoit son reflet, en guise de conclusion, par une longue course-poursuite dans une forêt, allant vers ce dépeuplement onirique, cette ouverture vers un espace décharné dans lequel s'inscrivent ces corps harassés.

L'intelligence de Chien enragé est qu'il joue sur l'ambiguïté de ce point de vue clivé, partagé entre la description noire du Japon d'après-guerre, société prise dans le désarroi, et le trouble désillusionné de son jeune héros. Jusqu'au bout le personnage tente, malgré la violence qu'il dégage, de conserver la frontière institutionnelle, entre le policier et le voyou. Il passera les menottes avant de s'effondrer à côté de celui qui lui ressemble tant, porté par la même rage, la même violence intérieure. Le policier désespéré interprété par Toshiro Mifune se confronte à celui, plus installé, car appartenant à une autre génération, joué par Takashi Shimura, un tandem bien souvent proposé chez Kurosawa, confrontant les différences dans le jeu, l'âge, le caractère et le physique. Le jeu de Mifune agit dans ce film comme le revers de son personnage, certes tout aussi noir, mais néanmoins plus romantique, de voyou dans l'Ange Ivre. Sa subtilité d'interprétation lui permet de gagner une intensité, là où Shimura propose un personnage plus sage, plus attachant, mais néanmoins conscient des indécisions de l'époque traversée. Plus qu'une traque haletante, Chien enragé est également le portrait d'une époque, le troublant point de vue sur une période sombre et divisée, un film qui, malgré son minimalisme, continue d'impressionner.
 Auteur illustrateur et créateur des mondes d'Iblard, un univers fantastique qui a servi de trame à un manga des années 1990, Naohisa Inoue est un très grand artiste impressionniste dont l'oeuvre a inspiré certains décors des films du studio Ghibli, tel le magnifique Whisper of the Heart. Ses peintures d'Iblard ont notamment été adaptées pour un court-métrage du Musée Ghibli, et l'homme a une amitié de longue date entretenue avec Hayao Miyazaki ou Isao Takahata.C'est cependant un peintre et un illustrateur qui s'impose avant tout en sa personne : Inoue ne fait pas de l'animation mais pratique plutôt un art du décor et de la touche. Evidemment, la correspondance avec le studio Ghibli est évidente, en particulier dans le motif du ciel, et dans son traitement impressionniste. Les nuages vaporeux et les traînées crépusculaires de l'artiste rejoignent les masses blanches et les ciels déclinants du Vent se lève ou du Voyage de Chihiro. Avec ce dernier se joue en particulier une série de clins d'oeil, allant des échoppes illuminées dans les rues nocturnes, des trains isolés en pleine campagne, au plaisir d'insérer dans le décor des animaux en tous genres (comme des cochons ou des grenouilles...) ou des étranges créatures.
Auteur illustrateur et créateur des mondes d'Iblard, un univers fantastique qui a servi de trame à un manga des années 1990, Naohisa Inoue est un très grand artiste impressionniste dont l'oeuvre a inspiré certains décors des films du studio Ghibli, tel le magnifique Whisper of the Heart. Ses peintures d'Iblard ont notamment été adaptées pour un court-métrage du Musée Ghibli, et l'homme a une amitié de longue date entretenue avec Hayao Miyazaki ou Isao Takahata.C'est cependant un peintre et un illustrateur qui s'impose avant tout en sa personne : Inoue ne fait pas de l'animation mais pratique plutôt un art du décor et de la touche. Evidemment, la correspondance avec le studio Ghibli est évidente, en particulier dans le motif du ciel, et dans son traitement impressionniste. Les nuages vaporeux et les traînées crépusculaires de l'artiste rejoignent les masses blanches et les ciels déclinants du Vent se lève ou du Voyage de Chihiro. Avec ce dernier se joue en particulier une série de clins d'oeil, allant des échoppes illuminées dans les rues nocturnes, des trains isolés en pleine campagne, au plaisir d'insérer dans le décor des animaux en tous genres (comme des cochons ou des grenouilles...) ou des étranges créatures.