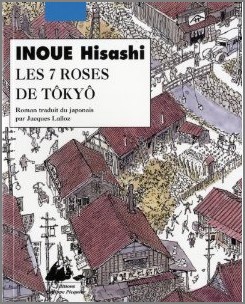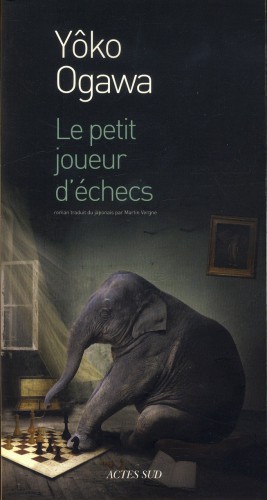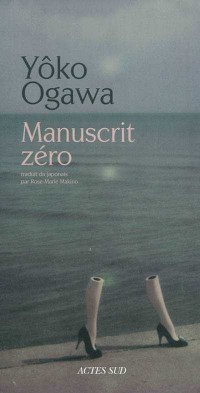ARRACHEZ LES BOURGEONS, TIREZ SUR LES ENFANTS (1958) - Kenzaburo Ôé

Le livre du Prix Nobel de Littérature s'avère, tout comme son titre, d'une véritable violence psychologique et physique. L'écriture fine et précise de Kenzaburo Ôé nous plonge dans un univers quasi-déshumanisé, d'une sensibilité à fleur de peau, et totalement engagée.
Arrachez les bourgeons, tirez sur les enfants suit les quelques jours d'une poignée d'enfants délinquants exilés sur les routes durant la 2ème Guerre Mondiale au Japon. Kenzaburo Ôé fait ainsi d'emblée partager le destin de protagonistes souvent oubliés dans l'horreur de la guerre, à savoir ces enfants vivant en centre pour jeunes délinquants, considérés comme une honte à la société, au statut bien plus bas que celui des paysans vivant dans la misère. Contraints de fuir sur les routes, ces enfants tentent de trouver un refuge auprès des villages, qui les rejette cependant comme s'ils n'étaient que de la vermine. Le récit dresse ainsi un portrait très cruel de ces populations prises dans la guerre et la misère, et qui ne font que se déchirer entre elles, et se rejeter mutuellement, les enfants devenant souvent les bêtes noires du village et s'avérant traités comme des animaux. L'un d'entre eux narre le récit d'une poignée de jours où le groupe se retrouve enfermé dans le village où s’est déclarée une épidémie. De fait, le film décrit très bien le danger et la cruauté des effets de foule, notamment dans les situations de crise : les villageois, eux-mêmes opprimés par les armées extérieures, choisissent de reporter leurs angoisses sur les populations étrangères (illustrée à travers le personnage de Lee, un jeune Coréen), les déserteurs, ou encore ces enfants, qui se retrouvent humiliés et injustement accusés au moindre prétexte.
L'action devient rapidement un huis-clos oppressant, où les enfants se retrouvent enfermés et condamnées dans le village, faisant face à l'abandon et à la peur d'une épidémie qui ne sera jamais officiellement déclarée. En une poignée de jours, c'est en véritable autarcie que les jeunes personnages vont tenter de survivre, s'organisant comme de véritables adultes sur cet enfer misérable et minimalisé. Ceci est l'occasion pur l'auteur d'aborder plusieurs thèmes essentiels, en filigrane et de manière métaphorique, tels l'amitié, l'amour et la sexualité, le sens du pouvoir et de la gouverne, la découverte de la mort et de la violence. Le désespoir finit par gagner ce qui incarne généralement l'essence de la pureté et de la naïveté, à savoir la population enfantine, qui doit au contraire affronter, se battre, surmonter, la dure réalité et la cruauté environnante.
Dans cette histoire bouleversante, le style de Kenzaburo Oé est sec, précis, oscillant entre un lyrisme poétique et un réalisme cru. La bestialité s'avère souvent présente dans les comportements, que ce soit dans une agressivité rageuse, une sexualité pauvre, ou l'effet de meute, les enfants se blottissant par exemple souvent les uns contre les autres pour survivre ou se réchauffer, partageant tout et détruisant toute forme d'intimité. Cependant, de nombreuses métaphores imagées colorent la narration à la première personne et décrivent, avec poésie, lyrisme, les rares instants de bonheur que collecte précieusement les personnages. Les joies pures de l'enfance, la sensation de liberté retrouvée lors d'un matin de neige, la maladresse du premier amour, la délicatesse développée autour des découvertes diverses, nourriture, faisan attrapé, fleurs... Mais la fin, tout comme l'ensemble de ce roman, montre la fuite en avant d'une poignée de personnages qui se déchirent et tentent de survivre, et, au-delà, d'une société prise dans l'horreur de la guerre.