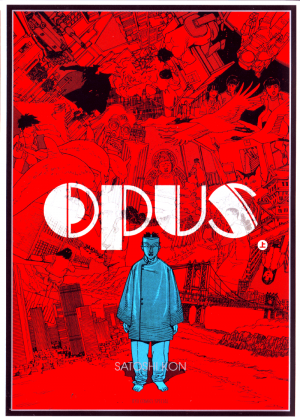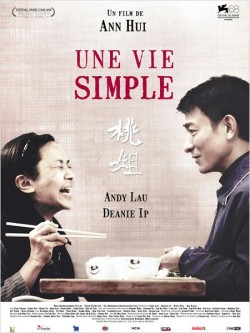Dichotomies
SHOKUZAI – Kiyoshi Kurosawa
CELLES QUI VOULAIENT SE SOUVENIR
CELLES QUI VOULAIENT OUBLIER

Après le drame familial de son précédent film, Shokuzai semble renouer avec l'horrifique, tout en continuant le prolongement de la critique sociale amorcé avec Tokyo Sonata. Diptyque réunissant 5 épisodes, ce nouveau film se révèle moins radical qu'un Cure ou qu'un Kaïro, plus dans le psychologique et frôlant le fantastique par moments. On songe à du Yoko Ogawa sous sa forme la plus crue, à certains mangas d'horreur ou encore aux figures féminines de Satoshi Kon. Mais malgré toutes ses références, le travail photographique et narratif du film se révèle unique en son genre, très surprenant par son audace et son efficacité.

En effet, Kurosawa prend à contrepied l'idée de la réminiscence. Il refuse, avec son scénario, la recherche de tout souvenir, et, au montage, se méfie des flash-backs. C'est bien plus la couleur du présent, propre à chacune des jeunes filles ayant vécu se drame et ayant été dans l'incapacité d'aider à se rappeler du meurtrier de leur camarade, qui intéresse le cinéaste. Comment ont-elles évolué ? Comment ont-elles vécues avec ce traumatisme ? Le film décline ainsi une esthétique du présent tout à fait étonnante : teinte froide, rendant les visages très pâles et la lumière éblouissante, comme désaturant tout sur son passage. Là où le passé apparaît bien souvent, dans la plupart des films mêlant plusieurs temporalités, comme peuplé d'images évanescentes, aux couleurs légères et aux contours estompés, le film de Kurosawa effectue le mouvement inverse. Son passé qui ouvre le film sur le drame vécu par les enfants est d'une esthétique classique, aux teintes marquées, tandis que le présent apparaît comme déjà « passé », vieilli, par sa photographie. Cette dernière trouve des accents définitivement surréels dans le premier ou le cinquième épisode, avec par exemple la transformation d'une chambre à coucher en terrifiante vitrine pour poupée. Ce choix entièrement assumé transforme d'emblée chaque récit en une lecture inquiétante, où l'atmosphère paraît sans cesse vaciller, prête à basculer dans le fantastique ou dans la subjectivité troublée de chaque personnage.


En outre, Kurosawa développe une figure fantôme nouvelle, non plus incarnée au travers d'un personnage ou d'un thème ou élément comme auparavant (le suicide dans Kaïro, l'amnésique démoniaque dans Cure, l'arbre dans Charisma), mais apportée par un lieu, autrement dit ce fameux gymnase, lieu du crime où s'est déroulé le drame. Les personnages se révèlent tous hantés par une image du corps de la petite Emili, alliée à une atmosphère du lieu, désert et plongé dans la pénombre. Le geste de la mère qui est de s'allonger par terre à l'emplacement exact du corps témoigne de cette hantise qui traverse tout le film et qui constitue la texture même de la réalisation de Kurosawa. Dès lors, des effets de réminiscence de cette atmosphère traversent chaque histoire, les liant entre elles par échos et créant un sentiment permanent de tension et de mystère, donnant à chacun des récits leur dimension tragique et angoissante. Le film réussit à transmettre une partie de la complexité psychologique décrite à travers cette histoire dans cette forme hybride et nouvelle.

Car Shokuzai embrasse avec ambition plusieurs thématiques liées à la société japonaise, en particulier le rapport au corps, à la sexualité, à l'affirmation de soi parmi les autres. C'est à ce niveau que le scénario de chacune des histoires, sauf à la rigueur celle du dernier volet qui renoue plus avec le style des années 90 de Kurosawa, rejoint les meilleurs écrivains japonais dans leur capacité subtile à saisir le malaise, et à balader les protagonistes entre cruauté, radicalité et pudeur, épure. Le film passe ainsi d'un registre à un autre – du drame du premier épisode aux accents vaudevillesques du quatrième – et touche par la finesse de description qu'il confère à ces femmes. Chacune est capturé, dans une scrupuleuse mise en scène des faits, dans son assimilation du traumatisme. Mais les récits ne les condamnent pas ou ne s'en limitent pas à leur unique mode de vie, faisant interagir une série de circonstances et de protagonistes parallèles étant là pour révéler cette assimilation. Le premier épisode fait rencontrer ainsi la timidité maladive d'une des jeunes filles avec la maniaquerie d'un schizophrène, tandis que le deuxième dresse un portrait cinglant des rapports de pouvoir au sein du système scolaire. Le troisième épisode, plus tendre et étonnant, mêle l'imaginaire d'une fille « ours », repliée sur elle-même, à une sombre histoire d'abus sur enfants, où des suggestions inquiétantes viennent frôler l'univers ludique de la jeune adulte. Le dernier épisode, conclusion du film, se révèle moins audacieux, approchant plus l'esthétique des films sud-coréens de vengeance, et rejoignant certaines figures de Kurosawa (les narrations parallèles, la rencontre inattendue avec le tueur, la course dans les bois, ou encore le regard extérieur des enquêteurs).

Par le film se révèle enfin une nouvelle facette de Kurosawa, celle de sa qualité à diriger des acteurs n'étant plus uniquement présents dans une dimension plastique ou corporelle. Il y eut certes l'inoubliable acteur fétiche du réalisateur dans Cure, Charisma, Doppelgänger, Koji Yakusho, mais jusqu'à présent – si on excepte Tokyo Sonata – la plupart des acteurs incarnaient des figures bien souvent aliénées, victimes et perdues dans la folie. Ici, dans Shokuzai, une vraie prégnance psychologique est attribuée aux protagonistes féminins, toutes interprétées excellemment dans chacun des volets. Enfin, la plus belle part est accordée au couple de Tokyo Sonata, qui se retrouvent ici dans des rôles aux antipodes de ce précédent film. Kyoko Koizumi incarne une veuve noire impressionnante, tandis que Teriyuki Kagawa – qui jouait également l'hikikomori dans Tokyo ! - propose une métamorphose radicale et une capacité de jeu et de maîtrise du corps impressionnante.

L'efficacité de Shokuzai est dans sa dichotomie : allier une photographie proche du noir et blanc à ce qui relève du présent tandis que les flash-backs demeurent dans des couleurs vives, dresser des caractères à la fois autant à la recherche du pardon que de la punition, brasser des actions antagonistes dans une réalisation élégante. Le nouveau film de Kurosawa se révèle tout en finesse, confirmant la maturité d'un cinéaste investissant de plus en plus sur de nouveaux terrains et matières de création.