L'Autre côté du Tunnel
- Retour sur le Voyage de Chihiro
LE VOYAGE DE CHIHIRO (2002) - Un film de Hayao Miyazaki
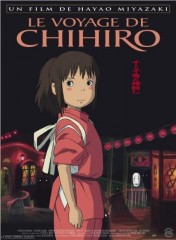
A l'occasion des dix ans du film-phare d'Hayao Miyazaki, un des rares films d'animation dans l'histoire du cinéma à avoir reçu de prestigieux prix, que ce soit le prix du Meilleur film asiatique à Hong Kong, l'Ours d'or de Berlin ou l'Oscar du Meilleur film d'animation à Hollywood, il est temps de revenir sur la particularité de ce long-métrage dans la filmographie des studios Ghibli. Atypique, tendrement nostalgique, mystique et mythologique, Le Voyage de Chihiro reste, avec les années, un des chefs d'oeuvre du cinéma d'animation, prouvant qu'au-delà de la qualité artistique réside une profonde humanité, imposant toujours autant le respect et l'admiration.

Prolongement et rupture
Pourquoi Le voyage de Chihiro, avec Princesse Mononoke, est-il le film le plus adulé des générations ayant découvert Miyazaki au début des années 2000, période où un grand nombre de ses œuvres fut projeté en salles et édité en DVD ? La force de Princesse Mononoke, et son succès, incombent à l'esprit épique du film, et à des valeurs écologiques en parfaite adéquation avec les interrogations du moment. Mais Le Voyage de Chihiro est, quant à lui, un film totalement atypique dans la filmographie de Miyazaki, un film dont le récit et les motifs sont peut-être les plus mystérieux et complexes à décrypter. C’est tout d'abord l'un des rares films des studios Ghibli (avec Pompoko d'Isao Takahata) à affirmer aussi fortement la culture asiatique, projetant son héroïne dans un monde mystique bardé de créatures inspirées de légendes, de dieux vivants, de yokai en tous genres, univers très spécifique à cette culture. Pourtant, le film, malgré cet ancrage asiatique, a séduit les foules, parce que Miyazaki a su trouver le moyen de faire accepter cet univers à son spectateur par le biais de son héroïne.

Et c'est là le second point qui différencie le Voyage de Chihiro des autres films de Miyazaki. Il existe un certain type d'héroïne chez le cinéaste, héroïnes plus ou moins âgées, de la petite fille à la femme naissante, de Kiki à Mononoke ou Sophie, mais qui s’imposent par leur force de caractère et leur courage. L'admiration connue de Miyazaki pour les femmes se manifeste dans ces figures auxquelles le spectateur doit s'accrocher, figures qui apportent l'univers du film, voire l'incarnent. C'est la sorcellerie fantaisiste de Kiki, le don de Nausicaa face aux Ohmus, les Totoros réconfortants de Mei, le secret du cristal de Shiita, la forêt monstrueuse et digne de San, ou encore le monde sous-marin de Ponyo. Il réside certes une exception avec Porco Rosso, seul film où le héros est masculin, mais les figures féminines qui y résident aspirent à la même définition. Chacune a son dynamisme, sa volonté de vivre et de découvrir, d'aimer face aux autres protagonistes et aux événements. Chihiro, dès l'ouverture du film, s'oppose d'emblée à toutes ces figures féminines. Le second plan du film découvre une gamine étendue à l'arrière de la voiture de ses parents, les yeux mi-clos, l'air las et désespéré, un bouquet de fleurs dans les bras. La gamine est chétive, molle, boudeuse, peureuse. Pleine de mauvaise foi, elle tire la langue à sa future nouvelle école, se plaint face à ses fleurs fanées, refuse de suivre ses parents à la lisière du tunnel. La suite du film confirmera cette impression, les réactions de Chihiro s'avérant spontanées, naïves, et l'égarement tenace. Nous sommes loin de la gaieté de Kiki ou de Shiita, loin de la force de caractère de San ou de Nausicaa. Il est de même pour le tracé du protagoniste : par opposition à l'élégance sensuelle de ses pairs féminines, ou aux douces formes rondes naissantes des autres jeunes filles, Chihiro s'avère frêle et chétive, gamine commune, inaperçue, discrète, loin de l'image de l'héroïne. C'est peut-être pour cela, paradoxalement, que l'identification s'avère plus facile, que l'attachement à cette fillette est immédiat, tant ses réactions de base s'avèrent compréhensibles car communes.

Quête existentielle
Tout comme la traduction française l'indique assez justement, Le Voyage de Chihiro est le périple existentiel de cette petite fille. L'imaginaire mystique auquel elle est confronté, ainsi que les nombreuses péripéties et les multiples personnages rencontrés la poussent à faire des choix  et à affirmer sa personnalité. Le passage chez Yubaba est la première étape pour Chihiro : elle y clame vigoureusement sa présence pour y avoir un travail. L'attachement au travail permet en effet dans ce milieu d'avoir une place. Par ce désir, Chihiro s'insère dans un système, dans une forme de société, si imaginaire soit-elle, s'intègre au mouvement des adultes et à un rythme tourbillonnant autre que celui de sa vie de petite fille. Cette insertion passe par exemple par le changement de nom, nom volé par la sorcière Yubaba. Une insertion ainsi cruelle, où l'identité de petite fille doit s'effacer pour se fondre dans la masse des employés. Paradoxalement, si Chihiro perd une part de son identité au début du film (retrouvée par l'aide de Haku, qui récupère les vêtements et le bouquet de fleurs fanées, symboles nostalgiques de l'enfance volée), elle gagne une certaine reconnaissance dans le milieu des bains avec l'épisode du Dieu Putride. Cette phase de reconnaissance est par ailleurs la première étape vers la reconnaissance de son identité, voire une forme de reconstruction. C'est durant cet épisode que Chihiro aura le premier flash-back du souvenir de son enfance. Par la suite, le film jouera sans cesse entre mémoire et avenir, entre part d'enfance et part de reconstruction : découvertes initiatiques pour Chihiro de la peur, du danger, mais aussi de l'amitié, du pouvoir ; tout en laissant sa part à la nostalgie d'enfance. Le souvenir lié à la première rencontre avec Haku, certes, mais plus encore le retour final à l'équilibre, boucle bouclée face au début du film, accompagné par la mélodie volontiers mélancolique composée par Joe Hisaishi.
et à affirmer sa personnalité. Le passage chez Yubaba est la première étape pour Chihiro : elle y clame vigoureusement sa présence pour y avoir un travail. L'attachement au travail permet en effet dans ce milieu d'avoir une place. Par ce désir, Chihiro s'insère dans un système, dans une forme de société, si imaginaire soit-elle, s'intègre au mouvement des adultes et à un rythme tourbillonnant autre que celui de sa vie de petite fille. Cette insertion passe par exemple par le changement de nom, nom volé par la sorcière Yubaba. Une insertion ainsi cruelle, où l'identité de petite fille doit s'effacer pour se fondre dans la masse des employés. Paradoxalement, si Chihiro perd une part de son identité au début du film (retrouvée par l'aide de Haku, qui récupère les vêtements et le bouquet de fleurs fanées, symboles nostalgiques de l'enfance volée), elle gagne une certaine reconnaissance dans le milieu des bains avec l'épisode du Dieu Putride. Cette phase de reconnaissance est par ailleurs la première étape vers la reconnaissance de son identité, voire une forme de reconstruction. C'est durant cet épisode que Chihiro aura le premier flash-back du souvenir de son enfance. Par la suite, le film jouera sans cesse entre mémoire et avenir, entre part d'enfance et part de reconstruction : découvertes initiatiques pour Chihiro de la peur, du danger, mais aussi de l'amitié, du pouvoir ; tout en laissant sa part à la nostalgie d'enfance. Le souvenir lié à la première rencontre avec Haku, certes, mais plus encore le retour final à l'équilibre, boucle bouclée face au début du film, accompagné par la mélodie volontiers mélancolique composée par Joe Hisaishi.

Par ailleurs, parallèlement à cette quête existentielle du personnage principal, un autre protagoniste suit son chemin, de manière plus symbolique et fantasmagorique : il s'agit de Sans-visage, l'étrange monstre qui s'infiltre dans le royaume des bains grâce à Chihiro. Le nom même de Sans-Visage, ainsi que son apparence fantomatique, son visage s'apparentant à un masque, en fait un personnage en quête vorace d'une identité, avalant grenouilles, femmes et crapauds des bains, s'empiffrant littéralement des corps des autres pour combler une absence de reconnaissance. Ce personnage, qui était à la base le point de départ du film, trouvera sa place auprès de Zeniba, la sœur jumelle de Yubaba.

Alice, les contes et les mythes
 D'emblée, dès le début du film, la comparaison avec Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, ou même avec Alice de l'autre côté du miroir, s'avère inévitable. La thématique du tunnel (que l'on retrouve également chez Ponyo à la fin du film) fait songer au tunnel dévalé par Alice. Mais, par opposition, là où Alice traverse à toute vitesse un lieu de passage en bric-à-brac et d'objets divers, Chihiro s'engouffre dans un tunnel sombre et silencieux, extrêmement sobre mais qui révélera par la suite des décors d'une très grande richesse ornementale. De plus, la symbolique des portes, du passage, du mouvement d'un espace à une autre, crible tout le film : le pont qui doit être traversé sans respirer, premier rituel de passage pour Chihiro, la porte de derrière pour aller voir le vieux Yamaji, les escaliers dangereux, l'ascenseur, les multiples portes des appartements de Yubaba, et surtout le passage fleuri emblématique du film, où Chihiro s'engouffre dans un champ de fleurs roses, celles-ci étant un écho direct au bouquet qui ouvre le film. Tout, dans Le Voyage de Chihiro, n'est que passage, traversée vers l'au-delà, d'une pièce à une autre, d'un étage à l'autre, d'un milieu à un autre, verticalement, horizontalement, en diagonale même, de l'eau (les bains) au ciel (le retour sur le dos du dragon). Et ces passages traduisent une forme de traversée mystique, vers un imaginaire autre, voire un enfer.
D'emblée, dès le début du film, la comparaison avec Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, ou même avec Alice de l'autre côté du miroir, s'avère inévitable. La thématique du tunnel (que l'on retrouve également chez Ponyo à la fin du film) fait songer au tunnel dévalé par Alice. Mais, par opposition, là où Alice traverse à toute vitesse un lieu de passage en bric-à-brac et d'objets divers, Chihiro s'engouffre dans un tunnel sombre et silencieux, extrêmement sobre mais qui révélera par la suite des décors d'une très grande richesse ornementale. De plus, la symbolique des portes, du passage, du mouvement d'un espace à une autre, crible tout le film : le pont qui doit être traversé sans respirer, premier rituel de passage pour Chihiro, la porte de derrière pour aller voir le vieux Yamaji, les escaliers dangereux, l'ascenseur, les multiples portes des appartements de Yubaba, et surtout le passage fleuri emblématique du film, où Chihiro s'engouffre dans un champ de fleurs roses, celles-ci étant un écho direct au bouquet qui ouvre le film. Tout, dans Le Voyage de Chihiro, n'est que passage, traversée vers l'au-delà, d'une pièce à une autre, d'un étage à l'autre, d'un milieu à un autre, verticalement, horizontalement, en diagonale même, de l'eau (les bains) au ciel (le retour sur le dos du dragon). Et ces passages traduisent une forme de traversée mystique, vers un imaginaire autre, voire un enfer.

De fait, Le Voyage de Chihiro fait songer au conte, ou encore au mythe d'Orphée, avec son atmosphère mystérieuse et ses allusions poétiques. Chihiro bascule dans le monde des non-vivants, où les parents sont transformés en cochons tels des enfants pris au piège d'une sorcière. La scène de goinfrerie rappelle le conte d'Hansel et Gretel, qui s'incarne aussi dans la goinfrerie de Sans-visage réclamant des plats luxueux aux employés des bains. Et la structure des Bains rappelle elle-même un décor de conte, avec ses abords richement décorés, à tendance dorée ou rouge sombre, emplie de fresques, d'étoffes et de décorations multiples. La « teinte » du film est en elle-même particulière et atypique au vu de la couleur des autres films de Miyazaki : plus chaleureuse, plus exotique, les traits s'avèrent plus fins, les détails plus luxueux, et la lumière plus tamisée. Etrangeté du décor et de la cinématographie qui font de Chihiro un espace mystique, rappelant la richesse des temples chinois.

Quant au mythe d'Orphée, il se retrouve dans la comparaison au royaume des morts, mais également dans une inversion du mythe. Orphée descend aux Enfers, se heurtant aux vents et aux obstacles, tandis que Chihiro est au contraire poussée vers le lieu maudit, poussée par ses parents ou par le vent qui s'engouffre dans le tunnel. Lorsque la nuit tombe, les rues sont peuplées de fantômes, des silhouettes noires transparentes, sortes d'âmes en peine rappelant les âmes des morts. Et bien évidemment, Chihiro doit quitter ce petit royaume sans se retourner, à l'image d'Orphée quittant les lieux avec Eurydice à la seule condition de ne pas la regarder dans les yeux.

Enfin, il faut revenir sur les deux symboles emblématiques du film, à savoir l'eau et le train. Tous représentent l'idée du mouvement, mais un mouvement rétrospectif, vers le passé. L'eau est le symbole inévitable du cours du temps, marquant toutes les étapes initiatiques de Chihiro : le ruisseau traversé après le passage du tunnel, la forte nuit de pluie, la chute dans le bain du Dieu Putride, l'immense lac traversé à pieds jusqu'au train, et enfin ce souvenir d'enfance résolvant la clé du nom de Haku. Le train, quant à lui ouvre le film et c'est après son passage que Chihiro rencontre Haku. C'est ensuite à bord de ce train que le spectateur sera amené à quitter pour un instant le royaume des Bains et à découvrir des stations de gare isolées, flottantes, aux personnages énigmatiques. La musique de Joe Hisaishi, sur cette séquence, s'avère particulièrement mélancolique, créant une pause temporelle dans le rythme du film, l'avancée de Chihiro étant brusquement interrompue par ce retour à la paisibilité (le train avançant dans le sens inverse de celui du temps, allant de la droite vers la gauche), prolongé par la suite avec la visite dans la demeure de Zeniba, chaleureux foyer perdu dans la forêt. Tout comme dans tous ses films, le passé et le mouvement constituent pour Miyazaki un thème important et essentiel dans la construction de l'identité de ses œuvres : c'est par le retour au souvenir, aux sources que Chihiro retrouvera l'harmonie de sa vie de petite fille, tout en ayant grandi. Une forme de reconstruction identitaire peu à peu gagnée de l'autre côté du tunnel.

 Tatsumi respecte tout d'abord très profondément le style de l'auteur, le film se basant sur une animation traditionnelle, avec un mouvement saccadé bien propre aux débuts de l'animation. Selon les histoires, chaque réalisation a son propre « grain », sa propre esthétique visuelle : « l'Enfer » le récit sur Hiroshima, qui ouvre le film, se rapproche du vieux film des années 50 en noir et blanc ; « My beloved Monkey », fable terrifiante sur la condition des ouvriers, opte pour un style dépouillé et sec ; « Juste un homme » est une amère vision sur les frustrations sexuelles ; « Occupé » oscille entre le film social et le film noir ; tandis que « Goodbye » se rapproche plus de l’esthétique des années 20. Toutes ces histoires partagent cependant la même noirceur, extrêmement crues et cruelles dans leurs conclusions, ce que Yoshihiro Tatsumi avouera à la fin du film en voix-off, constatant que ses premiers récits de « gekiga » reflétaient son propre désespoir de l'époque où il vivait, en tant que jeune dessinateur, dans la misère et l'anonymat.
Tatsumi respecte tout d'abord très profondément le style de l'auteur, le film se basant sur une animation traditionnelle, avec un mouvement saccadé bien propre aux débuts de l'animation. Selon les histoires, chaque réalisation a son propre « grain », sa propre esthétique visuelle : « l'Enfer » le récit sur Hiroshima, qui ouvre le film, se rapproche du vieux film des années 50 en noir et blanc ; « My beloved Monkey », fable terrifiante sur la condition des ouvriers, opte pour un style dépouillé et sec ; « Juste un homme » est une amère vision sur les frustrations sexuelles ; « Occupé » oscille entre le film social et le film noir ; tandis que « Goodbye » se rapproche plus de l’esthétique des années 20. Toutes ces histoires partagent cependant la même noirceur, extrêmement crues et cruelles dans leurs conclusions, ce que Yoshihiro Tatsumi avouera à la fin du film en voix-off, constatant que ses premiers récits de « gekiga » reflétaient son propre désespoir de l'époque où il vivait, en tant que jeune dessinateur, dans la misère et l'anonymat. doublage n'hésitant pas à souligner les passages mélodramatiques ou l'étalage de la souffrance, de même que la réalisation appuie trop souvent sur les passages sexuels alors qu'ils sont peu présents dans les planches originelles. Le meilleur récit reste de loin le premier, stupéfiante histoire sur un fictionnel cliché pris par un jeune homme peu de temps après la catastrophe d'Hiroshima, cliché dont l'interprétation allait être faussée au niveau international. Le récit s'avère terrifiant, passant du témoignage historique au film noir, et montrant le danger du pouvoir des images.
doublage n'hésitant pas à souligner les passages mélodramatiques ou l'étalage de la souffrance, de même que la réalisation appuie trop souvent sur les passages sexuels alors qu'ils sont peu présents dans les planches originelles. Le meilleur récit reste de loin le premier, stupéfiante histoire sur un fictionnel cliché pris par un jeune homme peu de temps après la catastrophe d'Hiroshima, cliché dont l'interprétation allait être faussée au niveau international. Le récit s'avère terrifiant, passant du témoignage historique au film noir, et montrant le danger du pouvoir des images.








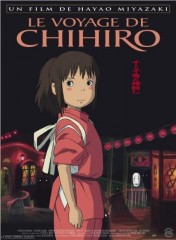



 et à affirmer sa personnalité. Le passage chez Yubaba est la première étape pour Chihiro : elle y clame vigoureusement sa présence pour y avoir un travail. L'attachement au travail permet en effet dans ce milieu d'avoir une place. Par ce désir, Chihiro s'insère dans un système, dans une forme de société, si imaginaire soit-elle, s'intègre au mouvement des adultes et à un rythme tourbillonnant autre que celui de sa vie de petite fille. Cette insertion passe par exemple par le changement de nom, nom volé par la sorcière Yubaba. Une insertion ainsi cruelle, où l'identité de petite fille doit s'effacer pour se fondre dans la masse des employés. Paradoxalement, si Chihiro perd une part de son identité au début du film (retrouvée par l'aide de Haku, qui récupère les vêtements et le bouquet de fleurs fanées, symboles nostalgiques de l'enfance volée), elle gagne une certaine reconnaissance dans le milieu des bains avec l'épisode du Dieu Putride. Cette phase de reconnaissance est par ailleurs la première étape vers la reconnaissance de son identité, voire une forme de reconstruction. C'est durant cet épisode que Chihiro aura le premier flash-back du souvenir de son enfance. Par la suite, le film jouera sans cesse entre mémoire et avenir, entre part d'enfance et part de reconstruction : découvertes initiatiques pour Chihiro de la peur, du danger, mais aussi de l'amitié, du pouvoir ; tout en laissant sa part à la nostalgie d'enfance. Le souvenir lié à la première rencontre avec Haku, certes, mais plus encore le retour final à l'équilibre, boucle bouclée face au début du film, accompagné par la mélodie volontiers mélancolique composée par Joe Hisaishi.
et à affirmer sa personnalité. Le passage chez Yubaba est la première étape pour Chihiro : elle y clame vigoureusement sa présence pour y avoir un travail. L'attachement au travail permet en effet dans ce milieu d'avoir une place. Par ce désir, Chihiro s'insère dans un système, dans une forme de société, si imaginaire soit-elle, s'intègre au mouvement des adultes et à un rythme tourbillonnant autre que celui de sa vie de petite fille. Cette insertion passe par exemple par le changement de nom, nom volé par la sorcière Yubaba. Une insertion ainsi cruelle, où l'identité de petite fille doit s'effacer pour se fondre dans la masse des employés. Paradoxalement, si Chihiro perd une part de son identité au début du film (retrouvée par l'aide de Haku, qui récupère les vêtements et le bouquet de fleurs fanées, symboles nostalgiques de l'enfance volée), elle gagne une certaine reconnaissance dans le milieu des bains avec l'épisode du Dieu Putride. Cette phase de reconnaissance est par ailleurs la première étape vers la reconnaissance de son identité, voire une forme de reconstruction. C'est durant cet épisode que Chihiro aura le premier flash-back du souvenir de son enfance. Par la suite, le film jouera sans cesse entre mémoire et avenir, entre part d'enfance et part de reconstruction : découvertes initiatiques pour Chihiro de la peur, du danger, mais aussi de l'amitié, du pouvoir ; tout en laissant sa part à la nostalgie d'enfance. Le souvenir lié à la première rencontre avec Haku, certes, mais plus encore le retour final à l'équilibre, boucle bouclée face au début du film, accompagné par la mélodie volontiers mélancolique composée par Joe Hisaishi.

 D'emblée, dès le début du film, la comparaison avec Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, ou même avec Alice de l'autre côté du miroir, s'avère inévitable. La thématique du tunnel (que l'on retrouve également chez
D'emblée, dès le début du film, la comparaison avec Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, ou même avec Alice de l'autre côté du miroir, s'avère inévitable. La thématique du tunnel (que l'on retrouve également chez 























 Rivalité et Amitié
Rivalité et Amitié entre les deux figures enfantines, c'est dans la retranscription de la passion musicale. Piano forest a bien évidemment une valeur très pédagogique, alliant à son animation simple et épurée la douceur des rythmes de Chopin, de Beethoven ou de Mozart, voulant sensibiliser le jeune public à la musique classique. L'animation permet d'allier au rythme pianistique des mouvements fluides et généreux, embrassant les arbres, la végétation et les visages dans un même mouvement circulaire, à l'image de l'harmonie et du calme que retrouve Kai lors de ses performances au piano. Car le film se concentre sur la figure de Kai, où s'oppose à la fois la violence et la douceur, la rage et la légèreté, l'ardeur de sa chevelure rousse et la dextérité de ses doigts fins. A travers Kai, figure bien plus attachante et intéressante que Shuhei, se retranscrit la plus forte émotion du film : celle d'une image d'enfance mélodieuse et harmonieuse, secrètement cachée derrière les arbres, recherchée par le professeur du film (qui deviendra une figure de père de substitution pour Kai, un peu comme s'il essayait de conserver ce secret). Piano Forest se veut, au final, éviter tout flash-forward, préférant finir sur l'image nostalgique de ce piano à l'abri dans la forêt, abri de l'enfance, de l'innocence, du bonheur.
entre les deux figures enfantines, c'est dans la retranscription de la passion musicale. Piano forest a bien évidemment une valeur très pédagogique, alliant à son animation simple et épurée la douceur des rythmes de Chopin, de Beethoven ou de Mozart, voulant sensibiliser le jeune public à la musique classique. L'animation permet d'allier au rythme pianistique des mouvements fluides et généreux, embrassant les arbres, la végétation et les visages dans un même mouvement circulaire, à l'image de l'harmonie et du calme que retrouve Kai lors de ses performances au piano. Car le film se concentre sur la figure de Kai, où s'oppose à la fois la violence et la douceur, la rage et la légèreté, l'ardeur de sa chevelure rousse et la dextérité de ses doigts fins. A travers Kai, figure bien plus attachante et intéressante que Shuhei, se retranscrit la plus forte émotion du film : celle d'une image d'enfance mélodieuse et harmonieuse, secrètement cachée derrière les arbres, recherchée par le professeur du film (qui deviendra une figure de père de substitution pour Kai, un peu comme s'il essayait de conserver ce secret). Piano Forest se veut, au final, éviter tout flash-forward, préférant finir sur l'image nostalgique de ce piano à l'abri dans la forêt, abri de l'enfance, de l'innocence, du bonheur.