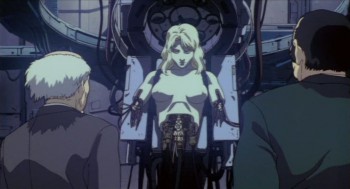De ciels en ciels
KAZE TACHINU – LE VENT SE LEVE, IL FAUT TENTER DE VIVRE – Hayao Miyazaki

Lorsque Miyazaki débuta son projet de biopic autour de l'ingénieur en aviation Jiro Horikoshi, Toshio Suzuki confia que sa prochaine réalisation serait un grand changement et demeurerait marquée par la catastrophe de Fukushima. Plutôt que de s'attarder sur le caractère final et conclusif du dernier long-métrage de Miyazaki, cette déclaration du producteur du studio et grand ami du cinéaste se révèle bien plus importante pour saisir Kaze Tachinu. Le film opère en effet un virage à 180 degrés dans l'univers animé du cinéaste, proposant un rythme, une narration, une vision du monde étonnamment en rupture avec ses œuvres précédentes. La féérie persiste mais elle est ici comme un obstacle résistant difficilement au réalisme le plus noir, le plus fragile. Kaze Tachinu demeure ainsi l'oeuvre la plus angoissante de Hayao Miyazaki, certes imprégnée de réalisme, mais également de romantisme, d'onirisme, traversant une étonnante diversité de tons.

Le cinéma de Miyazaki n'est en effet plus tout à fait le même avec ce film. Mais pour en apprécier la force, il faut en accepter ce changement, et pleinement s'en emparer. Plus latent, plus expérimental, plus audacieux dans ses partis pris également, Kaze Tachinu se rapproche plutôt de l'oeuvre du maître adulé de Miyazaki, à savoir Isao Takahata. Certaines touches de mise en scène, certaines choix de narration, d'attachement à des détails, rappellent la précision documentaire de l'animation chez Takahata. Les petits gestes du quotidien, tel le pliage d'un avion en papier, le bruissement des feuilles de cresson avalées goulûment par un Allemand, le jeu romantique d'une terrasse à un buisson, le roulement d'une mécanique discrète ou le froissement des pages au travail construisent peu à peu une mélodie de la quotidien, ou plus largement d'une vie, celle de cet ingénieur passionné.

Comment embrasser une vie entière sur l'échelle d'un film d'animation ? Le scénario de Miyazaki et sa réalisation sensible y répondent par ces choix, très minutieux, très subtils, de l'émotionnel qui traverse le personnage. L'écriture permute sans cesse de l'intime au général, mêlant par des actions minimes la grande Histoire du Japon – et même celle de l'Europe – à celle du sentiment personnel. L'approche du fascisme et de la Seconde Guerre Mondiale trouvent ainsi leur écho, leur représentation sous-jacente, dans un fugitif croisé dans la rue, dans l'apparent calme paisible vécu sur la « Montagne Magique » où courent cependant des chuchotements sur la guerre. Le film glisse dans ces moments des expérimentations, d'audacieuses subtilités dans l'animation : la fuite du fugitif se transforme en un condensé d'ombres expressionnistes, soulignant l'inquiétude d'un événement frôlant la balade nocturne de Jiro et son ami. L'étrangeté qui s'en dégage se plie alors à l'étrangeté de l'atmosphère de cette époque, où tout semble se jouer en coulisses, dans une totale invisibilité, pris dans un chaos confus que les apparences et la quotidienneté du travail de Jiro tentent de contenir. D'années en années, ce sont des failles qui se glissent entre les déplacements de Jiro et l'évolution de sa carrière. À la perfection de ses créations, à son admiration pour les mécaniques logiques, répondent les imperfections de la vie, tour-à-tour plaisantes ou bien effrayantes.

La fantaisie ou le fantastique se font plus ainsi discrets, plus disséminés dans une retranscription réaliste des années 1930. La faille la plus concrète dans cette époque demeure celle, sidérante de force sur grand écran, du tremblement de terre du Kanto. Le film lui confère son potentiel monstrueux... en le considérant comme un véritable monstre, dans la lignée du Sans-Visage poursuivant Chihiro ou du Roi de la forêt de Princesse Mononoke, rythmé par des bruits de bouche et des raclements rauques, craquelant les surfaces, enflammant le ciel. Cette puissance violente, désastreuse, comme héritière des ciels brûlants et fumants du Tombeau des Lucioles (Isao Takahata), vient rapidement marquer Kaze Tachinu, lui conférer la présence de la menace. Sa puissance terrifiante hantera les lieux et les événements observés par Jiro, traversant un geste, une ombre courante, un jet de sang sur une colline, une présence militaire.

À cette menace répondent cependant, fidèle aux vers de Paul Valéry, les imperfections sentimentales de Jiro. Son récit avec Naoko fait traverser un romantisme assumé, volontiers inaltérable et intemporel dans cette époque troublée, suspendant sur près d'un quart du film la menace présente. Miyazaki propose pour la première fois une histoire d'amour complète, où son animation vient à scander au compte-goutte les envolées du sentiment éprouvé, l'attente et le besoin de l'autre. Les étreintes de Naoko et Jiro sur un quai de gare ou leur précipitation d'un lieu à celui où se trouve l'autre partage quelque chose du bouleversant cercle fusionnel porté par Chihiro et Haku dans le Voyage de Chihiro. Les thèmes autour de Naoko conservent l'épure et la délicatesse chères au pianiste Joe Hisaishi, qui compose dans ce film une nouvelle bouleversante partition. Par les progressives déclinaisons d'un thème empreint de pudeur, ses notes brassent les niveaux de rapprochement ou de distance amoureux se jouant entre Naoko et Jiro. La sentimentalité et ses mouvements gagnent aussi l'amitié, à travers la relation à la fois comique et sincère partagée avec le patron de Jiro, l'attachement à la jeune sœur ou encore, investissant un terrain nouveau, l'étrange rivalité avec le collègue et ami Honjô.

L'évolution du ciel, palpable, fait traverser les états d'âme de Jiro et son rapport à ces divers personnages. D'un ciel à l'autre, son regard se transforme, d'abord idéaliste, puis pessimiste, passionné, amoureux, troublé. A travers les états célestes, Miyazaki incarne une véritable cartographie humaine. Le premier ciel d'ouverture est celui de l'onirisme, celui d'un rêve d'enfant. Les suivants seront ceux, triomphants, enveloppés d'une sensualité ronde proche de l'atmosphère de Porco Rosso, du maître Caproni, ingénieur italien sur lequel Jiro prend modèle. L'état de l'excitation du jeune homme apparaît au travers de séquences à l'animation à la fois bouleversante et discrète. Miyazaki déploie dans chacun de ses films ce phénomène, propre à lui, d'un mouvement rendu épique dans un contexte minimalisant. Ici, le souffle de l'inspiration, dans lequel se niche celui de l'espoir, gagne sa retranscription dans des effets de projections mentales où, penché au milieu de ses collègues, Jiro se concentre, puis devient traversé par le souffle de la création, de l'inventivité, la couleur de son front laissant traverser les mouvements souples de ses machines. L'outil d'instruments « d'époque » dans la partition d'Hisaishi, comme l'accordéon ou la guitare en particulier, confèrent un parfum d'époque rendant magnifiquement compte de cet optimisme et de cette inspiration du scientifique.

Kaze Tachinu parvient enfin à cristalliser, par sa subtile animation, par son attention minutieuse, la portée de la menace invisible. Derrière les ciels romantiques et machineries fantaisistes qu'imagine Jiro gronde le danger d'une réalité se débarrassant d'un tel onirisme. Lors du décollage de sa création, en dépit de la joie de ses employeurs, Jiro voit cependant son regard – et le nôtre avec – se décaler, se déplacer inconsciemment et sans explication. Le monde harmonieux de Miyazaki se déforme soudain, vacille quelques secondes, effrayante explosion pendant quelques secondes des repères rassurants qu'il avait parvenu à bâtir jusque-là, rejoignant le souffle incontrôlable du tremblement de terre ouvrant son récit. C'est la prise de conscience de la catastrophe, de la guerre à venir, du destin tragique de ces beaux avions, et c'est le vent qui se lève à son annonce.
Et lorsque l'ingénieur regarde les avions qu'il a créés s'écraser dans le feu et la fureur belliqueuse, ce désastre demeure cependant vu avec les yeux d'un poète, où les carcasses disparaissent dans les nuages, enveloppées dans des vagues roulantes et enflammées. Plus que le songe qui persiste, c'est le sentiment du sublime qui tend alors à percer.

 Auteur illustrateur et créateur des mondes d'Iblard, un univers fantastique qui a servi de trame à un manga des années 1990, Naohisa Inoue est un très grand artiste impressionniste dont l'oeuvre a inspiré certains décors des films du studio Ghibli, tel le magnifique Whisper of the Heart. Ses peintures d'Iblard ont notamment été adaptées pour un court-métrage du Musée Ghibli, et l'homme a une amitié de longue date entretenue avec Hayao Miyazaki ou Isao Takahata.C'est cependant un peintre et un illustrateur qui s'impose avant tout en sa personne : Inoue ne fait pas de l'animation mais pratique plutôt un art du décor et de la touche. Evidemment, la correspondance avec le studio Ghibli est évidente, en particulier dans le motif du ciel, et dans son traitement impressionniste. Les nuages vaporeux et les traînées crépusculaires de l'artiste rejoignent les masses blanches et les ciels déclinants du Vent se lève ou du Voyage de Chihiro. Avec ce dernier se joue en particulier une série de clins d'oeil, allant des échoppes illuminées dans les rues nocturnes, des trains isolés en pleine campagne, au plaisir d'insérer dans le décor des animaux en tous genres (comme des cochons ou des grenouilles...) ou des étranges créatures.
Auteur illustrateur et créateur des mondes d'Iblard, un univers fantastique qui a servi de trame à un manga des années 1990, Naohisa Inoue est un très grand artiste impressionniste dont l'oeuvre a inspiré certains décors des films du studio Ghibli, tel le magnifique Whisper of the Heart. Ses peintures d'Iblard ont notamment été adaptées pour un court-métrage du Musée Ghibli, et l'homme a une amitié de longue date entretenue avec Hayao Miyazaki ou Isao Takahata.C'est cependant un peintre et un illustrateur qui s'impose avant tout en sa personne : Inoue ne fait pas de l'animation mais pratique plutôt un art du décor et de la touche. Evidemment, la correspondance avec le studio Ghibli est évidente, en particulier dans le motif du ciel, et dans son traitement impressionniste. Les nuages vaporeux et les traînées crépusculaires de l'artiste rejoignent les masses blanches et les ciels déclinants du Vent se lève ou du Voyage de Chihiro. Avec ce dernier se joue en particulier une série de clins d'oeil, allant des échoppes illuminées dans les rues nocturnes, des trains isolés en pleine campagne, au plaisir d'insérer dans le décor des animaux en tous genres (comme des cochons ou des grenouilles...) ou des étranges créatures.