Suis-moi je te fuis / Fuis-moi je te suis
Exilé
EXILE (2007) - Johnnie To

Avant le ludique Sparrow et l'efficace Vengeance, Johnnie To avait réalisé Exilé, moins connu que son diptyque d'Election, mais qui se révèle pourtant être l'un de ses meilleurs derniers films. Lors de sa sortie, je l'avais vu au cinéma, n'ayant pas suffisamment d'expérience à l'époque au niveau de le critique d'un film, mais ayant été éblouie, angoissée, marquée par ce film qui joue habilement avec les codes du western et du film de gangster, accompagné d'une réalisation excellente. Sparrow, moins abouti, mais agréable, était une variation sur les pickpockets et la comédie musicale. Exilé reste au contraire un pur film de genre, aux nombreuses nouvelles idées de mise en scène et de scénario, mais qui ne perd jamais de sa force et de sa violence, toujours dans la peinture d'une organisation criminelle tyrannique et corrompant tout.

En quelques scènes d'une séquence d'ouverture inoubliable, le film esquisse les grandes lignes de l'intrigue qui va réunir ces quatre tueurs à gages dans leur exil. Sans avoir recours à des dialogues poussifs, loin de l'excitation verbale d'un Martin Scorsese, à travers une mise en scène taillée au scalpel, le spectateur saisit les rapports contradictoires qui unissent les cinq protagonistes, l'un, aussi tueur à gages de la bande, voulant se retirer du joug du terrible M. Fay. Autour de ce personnage se réunissent les quatre héros dans une séquence d'ouverture mémorable, hommage détonnant au western. Un travelling impressionnant vient tout d'abord cerner ces quatre protagonistes, faisant tout de suite saisir l'importance de leur place dans le récit. Pas de mots, juste un signe de tête et un geste d'une main tenant un cigare que vient souligner ce travelling, comme un code définissant leur union. A partir de là, ces quatre hommes ne se sépareront pas jusqu'à une mort quasi synchrone. Le travail de Johnnie To a toujours une vision de l'amitié qui se concrétise par l'action de groupe, par le rapport au nombre, donnant une égale dignité à chacun des membres tout en définissant une hiérarchie claire. Le Chat et Le Gros se révèlent dès le début les hommes de main, faisant le guet dans la rue, tandis que Tai et Blaze, les têtes pensantes du groupe, montent en haut s'occuper de Wo, le collègue voulant se retirer.

L'influence du western se pointe donc dès la première scène, une fusillade entre Tai, Blaze et Wo dans le petit salon désert d'un appartement de Macao, exacte réplique du célèbre triangle du Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Mais là où le final de Leone était la réunion attendue entre ses trois protagonistes, la séquence d'ouverture de To met en périple l'amitié qui liait ces amis d'enfance. De plus, là le film de Leone se finissait dans une arène dessinée par le plateau central d'un désert, véritable scène de tragédie, Exilé préfère un lieu commun, un salon autour duquel existent la cuisine avec la marmite sur le feu, la salle de bains, la femme et l'enfant de Wo. Si Johnnie To emprunte beaucoup de codes du western, il ne l'effectue qu'au niveau de la forme, le fond étant totalement différent. Les héros de Johnny To sont par exemple de grands sentimentaux, notamment Blaze, incapable de continuer la fusillade face aux cris de l'enfant réveillé et au regard de la femme. Ils sont comme l'incarnation de certaines valeurs en perdition dans le monde criminel, que tentent d'inhiber des antagonistes sans une once d'humanité, ce qu'incarne parfaitement l'extraordinaire, car fou, M.Fay.

Le scénario fait habilement succéder des variations sur les lieux communs du western et du film de gangsters, troublant les frontières et créant des quiproquos à la fois malicieux et tragiques. Ce curieux mélange des registres est extrêmement visible dans Sparrow, et transparaît aussi dans Exilé. Les cinq protagonistes sont par exemple chargés d'éliminer, sur ordre d'un indicateur, un jeune homme dans un restaurant sans savoir que cette cible a précisément rendez vous avec leur grand patron M. Fay. Ou un policier chinois, lors du braquage d'un convoi de fonds dans la lande désertique du pays, se révèle incarner le comportement type du héros américain, sorte de tireur d'élite nonchalant et inattaquable, ne manquant jamais sa cible tandis qu'échouent autour de lui tous ses camarades. La prostituée, quant à elle, grande figure du genre et commune au western et au film noir, sera le témoin égoïste de tous les événements et lorsque les quatre compères, juste avant de mourir, la contemplent descendant les marches de l'escalier pour les voir, ils ne se doutent pas que son seul but est de voler l'argent tombé à leurs pieds.

De plus, la structure s'apparente presque à celle d'une tragédie grecque, et le film peut se découper en trois grandes parties définies par les offensives. Au début, le trio s'attaque dans le petite pièce à l'image de la célèbre scène du Bon, la Brute et le Truand de Leone, constituant le premier acte. Après certains éclaircissements sur le dilemme qui va unir le groupe, la seconde offensive dans le restaurant luxueux de Macao clôt le second acte. De nombreuses péripéties mèneront finalement au dernier acte, apogée de la violence entre le groupe et Fay. Trois lieux se distinguent aussi, tous marqués par des scènes de fusillade : l'appartement, le restaurant, et l'hôtel. A ces lieux principaux et concentrant l'action et les personnages se rattachent d'autres lieux symboliques, telle la montagne, sorte de pivot spirituel pour les quatre hommes, les rues de Macao, ou le cabinet du médecin.
Il y a également ce ressort fondamental dans la structure de Johnnie To, qui est le personnage de la femme, souvent peu présent à l'écran mais jouant un rôle capital. Elle s'incarne ici en deux figures contradictoires, deux idéals totalement opposés et dont la rencontre entraînera finalement la perte des quatre hommes : la prostituée, obsédée par l'argent, et la femme de Wo, animée par une vengeance incertaine. Cette dernière est par ailleurs bien plus importante que la première, sorte de figure qui permettrait aux quatre brigands de se racheter une conduite. Ces deux images de femme se retrouvent par ailleurs dans le personnage de Kelly Lin dans Sparrow, mi-démon, mi-fragile.

Enfin, si le western marque la réalisation tout du long du film, les scènes de violence échappent et se distinguent de l'ensemble par la somptueuse composition qu'elles émettent. Par ailleurs, les derniers films de Johnnie To (et probablement ceux d'avant, bien que je n'ai pas eu encore l'occasion de les découvrir) ont largement prouvé son habileté à filmer les scènes d'action. Au-delà de l'hommage, les séquences de violence ont cette particularité de se distinguer de toute autre production d'action, pour constituer, à elles seules, des moments d'anthologie. Car tout l'esthétisme de la violence chez To s'incarne dans le travail chorégraphique qu'il opère, que ce soit dans l'image ou le son. Le ralenti a sa place majeure dans ces séquences, de même que l'espace du lieu, souvent restreint dans Exilé (alors qu'il est urbain dans Sparrow, et, par opposition, élargi dans Vengeance). Les manteaux claquent et les rideaux s'envolent, comme dans le cabinet du médecin, véritable réussite du suspense. Les tueurs virevoltent au rythme des pistolets qui se déchargent et des balles qui les transpercent ou les frôlent. La comédie musicale se retrouve même, malgré la noirceur du sujet, dans ces scènes inouïes, à la photographie exquise et aux mouvements de caméra sidérants. Ce qui constitue la force de ces scènes, c'est qu'elles allient à la fois une réalisation chorégraphique soignée et précieuse à la violence qu'elle reflète, évitant au film de tomber dans un excès esthétisant et dans la complaisance qu'accompagnent bien souvent les effets spéciaux dans les scènes d'action des films actuels, comme dans les derniers films de Martin Scorsese. Ici, le travail sur l'ombre et les corps crispés dans l'effort, l'harmonie des mouvements et l'organisation dans l'espace donnent une certaine efficacité à la scène de combat, une force dramatique et directe.

Exilé, ce titre s'accorde autant au personnage de Wo, qu'à ceux de la bande. Le sens de ce titre peut se lire autant dans le sens littéral que figuré : les quatre complices perdent leur confiance en leur chef et s'interroge quant aux décisions à prendre, et cette remise en question s'incarne dans leur errance aux alentours de Macao. Le meilleur symbole de cet exil est la fameuse pièce de monnaie, où le pile et le face finissent par déterminer chaque direction à prendre, chaque décision sur laquelle s'accorder, chaque destin auquel se vouer. Les quatre acteurs, Anthony Wong, Francis Ng Chun Yun, Suet Lam et Roy Cheung, incarnent parfaitement la complicité qui unit ces personnages, jouant toujours sur le double registre de la légèreté et du dramatique. Simon Yam, quant à lui, interprète Fay avec un dynamisme sidérant, mi-cynique, mi-sadique, toujours aussi excellent.

Ainsi, dans les espaces de Macao et au-delà, les cigares et les cigarettes fusent, les lunettes de soleil sont constamment glissées sur le nez, les mauvaises blagues tombent, les impers claquent et les voitures ne roulent plus. On finit par laisser tomber tout moyen de transport et à continuer le voyage à pied, comme une étrange odyssée, un exil de quatre tueurs à gages, et ce, toujours avec style.
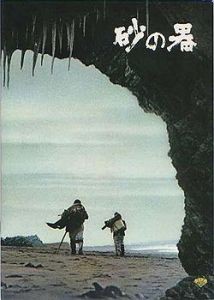 Adapté du
Adapté du 







 son travail dans de quelconques bureaux à Tokyo. Lorsqu'elle demande un congé pour passer des vacances à la campagne, la jeune femme posé et tranquille de Tokyo se transforme en une travailleuse dynamique et enthousiaste, aidant aux récoltes des fleurs de carthame, dont les pigments rouges sont utilisés par les teinturiers. C'est au cours de ces vacances paysannes que ses souvenirs d'enfance vont se manifester, d'abord par petites touches, puis de manière suffisamment fréquentes pour que la jeune femme ait envie de les raconter. Postulat assez simple, mais qui révèle bien des choses sur une jeune adulte. Là où le thème du souvenir est attendu avec des protagonistes âgés revenant sur les étapes de leur vie, c'est ici à travers une jeune femme que s'entame le processus de remémoration.
son travail dans de quelconques bureaux à Tokyo. Lorsqu'elle demande un congé pour passer des vacances à la campagne, la jeune femme posé et tranquille de Tokyo se transforme en une travailleuse dynamique et enthousiaste, aidant aux récoltes des fleurs de carthame, dont les pigments rouges sont utilisés par les teinturiers. C'est au cours de ces vacances paysannes que ses souvenirs d'enfance vont se manifester, d'abord par petites touches, puis de manière suffisamment fréquentes pour que la jeune femme ait envie de les raconter. Postulat assez simple, mais qui révèle bien des choses sur une jeune adulte. Là où le thème du souvenir est attendu avec des protagonistes âgés revenant sur les étapes de leur vie, c'est ici à travers une jeune femme que s'entame le processus de remémoration. Le trait est posé et harmonieux, l'ensemble ressemble à un film d'Ozu, avec son sens de la famille et sa nostalgie de l'image. Le film s'articule sur une série de scènes de l'enfance de Taiko, et l'influence d'Ozu se fait le plus sentir sur ces scènes : cadrage au niveau des tatamis et des personnages agenouillés, plans de groupe, même pudeur et simplicité des sentiments. Le film est marqué par une très grande justesse, saisit les moments de joies, de tristesse ou de tension avec une véritable retenue. Cette justesse permet la portée universelle des scènes décrites, malgré le contexte et les intérieurs japonais : la déception après l'ouverture d'un ananas, fruit rare à l'époque ; les disputes avec la grande sœur ; les illusions de carrière d'actrice après avoir joué dans une pièce à l'école ; l'arrivée des premières règles ; et bien évidemment
Le trait est posé et harmonieux, l'ensemble ressemble à un film d'Ozu, avec son sens de la famille et sa nostalgie de l'image. Le film s'articule sur une série de scènes de l'enfance de Taiko, et l'influence d'Ozu se fait le plus sentir sur ces scènes : cadrage au niveau des tatamis et des personnages agenouillés, plans de groupe, même pudeur et simplicité des sentiments. Le film est marqué par une très grande justesse, saisit les moments de joies, de tristesse ou de tension avec une véritable retenue. Cette justesse permet la portée universelle des scènes décrites, malgré le contexte et les intérieurs japonais : la déception après l'ouverture d'un ananas, fruit rare à l'époque ; les disputes avec la grande sœur ; les illusions de carrière d'actrice après avoir joué dans une pièce à l'école ; l'arrivée des premières règles ; et bien évidemment les premières amours... Mais Souvenirs goutte-à-goutte, par son système de fragmentation, obéit à un rythme posé et maîtrisé, donnant à ces scènes le naturel et l'émotion nécessaires pour éviter tout effet de lourdeur ou de stéréotype. De plus, on retrouve dans ces scènes toute une culture de l'époque : le style inachevé et pâle donne l'impression de voir un vieux dessin animé japonais, certains visages de Taeko enfant revêtissent même parfois le large regard naïf des personnages féminins des shojo de l'époque. De multiples références à des émissions, groupes musicaux de l'époque parsèment en outre les scènes nostalgiques.
les premières amours... Mais Souvenirs goutte-à-goutte, par son système de fragmentation, obéit à un rythme posé et maîtrisé, donnant à ces scènes le naturel et l'émotion nécessaires pour éviter tout effet de lourdeur ou de stéréotype. De plus, on retrouve dans ces scènes toute une culture de l'époque : le style inachevé et pâle donne l'impression de voir un vieux dessin animé japonais, certains visages de Taeko enfant revêtissent même parfois le large regard naïf des personnages féminins des shojo de l'époque. De multiples références à des émissions, groupes musicaux de l'époque parsèment en outre les scènes nostalgiques.  Enfin, les souvenirs sont mis en parallèle avec les vacances de Taiko à la campagne. Une large part est ainsi consacrée, en contraste avec le cocon de la maison d'enfance et de l'école, aux paysages naturels et à l'essence purifiante de la campagne. Alors que les souvenirs apparaissent dans un trait léger et des couleurs presque pastels et claires, la partie du présent est plus verdoyante, prononcée dans le style et les choix d'atmosphère. Le film revendique l'ostentation et la modestie des vies des paysans, et laisse sa place à l'harmonie des lieux et des sons. Des chants hongrois résonnent dans la montagne, le rouge des carthames s'imprime à l'écran. Le calme et la douceur de cette campagne mènent Taeko à la réflexion, la rêverie, le souvenir, ses pensées d'enfance reflétant au final les seules fortes émotions qu'elle a pu éprouver dans sa vie. Le retour à l'ensemble va de pair avec un retour aux sources, à la terre natale, à la terre du bonheur et de la vraie vie. Si Taeko commence à se souvenir dans un train, merveilleuse symbolique qu'on peut retrouver dans tous types de films, elle refuse au final de voyager dans le train du retour, préférant prendre ses valises, descendre de la voie toute tracée vers Tokyo, et de revenir à la terre qui lui plaît.
Enfin, les souvenirs sont mis en parallèle avec les vacances de Taiko à la campagne. Une large part est ainsi consacrée, en contraste avec le cocon de la maison d'enfance et de l'école, aux paysages naturels et à l'essence purifiante de la campagne. Alors que les souvenirs apparaissent dans un trait léger et des couleurs presque pastels et claires, la partie du présent est plus verdoyante, prononcée dans le style et les choix d'atmosphère. Le film revendique l'ostentation et la modestie des vies des paysans, et laisse sa place à l'harmonie des lieux et des sons. Des chants hongrois résonnent dans la montagne, le rouge des carthames s'imprime à l'écran. Le calme et la douceur de cette campagne mènent Taeko à la réflexion, la rêverie, le souvenir, ses pensées d'enfance reflétant au final les seules fortes émotions qu'elle a pu éprouver dans sa vie. Le retour à l'ensemble va de pair avec un retour aux sources, à la terre natale, à la terre du bonheur et de la vraie vie. Si Taeko commence à se souvenir dans un train, merveilleuse symbolique qu'on peut retrouver dans tous types de films, elle refuse au final de voyager dans le train du retour, préférant prendre ses valises, descendre de la voie toute tracée vers Tokyo, et de revenir à la terre qui lui plaît. 


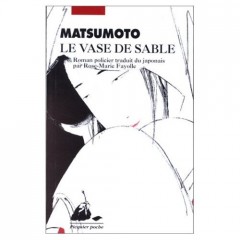 Seicho Matsumoto est un romancier japonais de la seconde moitié du 20ème siècle, réputé dans le domaine du policier comme étant le « Simenon japonais ». Cette appellation m'a poussée à m'intéresser à cet écrivain, étant une adepte de Simenon. Le Vase de Sable est l'une des enquêtes les plus célèbres de l'inspecteur Imanishi, le héros de Matsumoto, et fut adapté par le cinéaste Yoshitaro Nomura en 1974.
Seicho Matsumoto est un romancier japonais de la seconde moitié du 20ème siècle, réputé dans le domaine du policier comme étant le « Simenon japonais ». Cette appellation m'a poussée à m'intéresser à cet écrivain, étant une adepte de Simenon. Le Vase de Sable est l'une des enquêtes les plus célèbres de l'inspecteur Imanishi, le héros de Matsumoto, et fut adapté par le cinéaste Yoshitaro Nomura en 1974. 
 films coréens, à commencer par Poetry de Lee Chang-dong. L'esprit asiatique et sa conception cyclique du temps fait que le cinéma y empreint de bien plus d'ostentation que le cinéma occidental. La caméra saisit, de manière très posée et sincère, les événements, frontale par rapport aux lieux et aux personnages. Cette observation est quasi-clinique par moments, comme lors du réveil du sourd-muet après le vol de son rein par le trafiquants d'organes. Dans un travelling arrière tremblotant, la caméra s'assimile aux soubresauts du corps nu recroquevillé sur le sol du parking désert, laissant place peu à peu, par ce mouvement, à la souffrance du personnage, brutalement disséqué et abandonné comme une vulgaire poupée usée.
films coréens, à commencer par Poetry de Lee Chang-dong. L'esprit asiatique et sa conception cyclique du temps fait que le cinéma y empreint de bien plus d'ostentation que le cinéma occidental. La caméra saisit, de manière très posée et sincère, les événements, frontale par rapport aux lieux et aux personnages. Cette observation est quasi-clinique par moments, comme lors du réveil du sourd-muet après le vol de son rein par le trafiquants d'organes. Dans un travelling arrière tremblotant, la caméra s'assimile aux soubresauts du corps nu recroquevillé sur le sol du parking désert, laissant place peu à peu, par ce mouvement, à la souffrance du personnage, brutalement disséqué et abandonné comme une vulgaire poupée usée. l'éloignement face aux événements violents. Les plans sont souvent fixes et larges, embrassant toute une action et créant l'horrifique par cette distance imposée et cette fixité qui oblige à regarder en face les événements, sans pouvoir agir ou interagir. Par exemple, un employé s'tant fait licencier se mutile devant la voiture du personnage joué par Song Kang-ho, en pleine rue. On se regarde, on observe l'homme crier, puis se mutiler : totale rigidité des corps et des visages, figés entre le dégoût extrême et l'insensibilité. Le contraste entre l'ampleur de la violence et la rigidité de la mise en scène accentue ainsi la cruauté du propos et nous renvoie à une certaine condition ambiguë de spectateur. Park Chan-wook continuera notamment d'explorer ce phénomène de distance à travers Thirst, son dernier film.
l'éloignement face aux événements violents. Les plans sont souvent fixes et larges, embrassant toute une action et créant l'horrifique par cette distance imposée et cette fixité qui oblige à regarder en face les événements, sans pouvoir agir ou interagir. Par exemple, un employé s'tant fait licencier se mutile devant la voiture du personnage joué par Song Kang-ho, en pleine rue. On se regarde, on observe l'homme crier, puis se mutiler : totale rigidité des corps et des visages, figés entre le dégoût extrême et l'insensibilité. Le contraste entre l'ampleur de la violence et la rigidité de la mise en scène accentue ainsi la cruauté du propos et nous renvoie à une certaine condition ambiguë de spectateur. Park Chan-wook continuera notamment d'explorer ce phénomène de distance à travers Thirst, son dernier film.  visuel. Le meilleur exemple reste la séquence insupportable de la noyade de la petite fille, l'ellipse étant faite sur sa chute dans l'eau. Il se joue aussi une rupture avec la vision du personnage principal, ce sourd-muet qui reste indifférent face aux cris de la petite, alors que le spectateur peut entendre, s'imaginer le drame, a une longueur d'avance sur lui. Une même utilisation du son et des bruitages, qui prolonge l'imagination du spectateur et renforce la
visuel. Le meilleur exemple reste la séquence insupportable de la noyade de la petite fille, l'ellipse étant faite sur sa chute dans l'eau. Il se joue aussi une rupture avec la vision du personnage principal, ce sourd-muet qui reste indifférent face aux cris de la petite, alors que le spectateur peut entendre, s'imaginer le drame, a une longueur d'avance sur lui. Une même utilisation du son et des bruitages, qui prolonge l'imagination du spectateur et renforce la  violence, est présente lors des séquences où le personnage de Song Kang-ho, aveuglé par sa soif de vengeance, s'inflige des séances d'observation dans les salles d’opérations des médecins légistes. La suggestion agit aussi au niveau de la mise en scène et de l'agencement des différents plans à l'image. Park Chan-wook laisse sa place aux zones sombres de l'image, sème le doute quant aux actions effectuées pour la vengeance : l'eau, tout comme les pierres au bord du lac, les sacs en plastique et les vêtements cachent les blessures et les souffrances mais laissent imaginer le pire sous ce qui cache.
violence, est présente lors des séquences où le personnage de Song Kang-ho, aveuglé par sa soif de vengeance, s'inflige des séances d'observation dans les salles d’opérations des médecins légistes. La suggestion agit aussi au niveau de la mise en scène et de l'agencement des différents plans à l'image. Park Chan-wook laisse sa place aux zones sombres de l'image, sème le doute quant aux actions effectuées pour la vengeance : l'eau, tout comme les pierres au bord du lac, les sacs en plastique et les vêtements cachent les blessures et les souffrances mais laissent imaginer le pire sous ce qui cache.  rendent les protagonistes insensibles. La jeune fille amoureuse du sourd-muet parle ainsi de l'enlèvement de la petite fille comme d'un quelconque sujet. Les personnages sont désintéressés, finissent par acquérir toute distance avec tout ce qui les entoure, car ils se retrouvent laissés à l'abandon, vivant dans la misère. Cette vengeance pointe en outre un choc social avec le contraste entre le personnage du père de la petite, riche et manipulateur, et celui du sourd-muet, miséreux et quasi-autiste. Dans cette société dépeinte, la violence s'infiltre partout, l'argent étant souvent le déclencheur de toute cette violence et cruauté. Le trafic d'organes règne, et, dans ce milieu dévasté et déshumanisant, la vengeance s'infiltre sans grande difficulté. Dans ses films, Park Chan-wook arrive toujours à saisir l'insécurité et le désœuvrement, laissant ses personnages livrés à eux-mêmes, abandonnant les dialogues pour donner aux gestes une plus grande violence et cruauté.
rendent les protagonistes insensibles. La jeune fille amoureuse du sourd-muet parle ainsi de l'enlèvement de la petite fille comme d'un quelconque sujet. Les personnages sont désintéressés, finissent par acquérir toute distance avec tout ce qui les entoure, car ils se retrouvent laissés à l'abandon, vivant dans la misère. Cette vengeance pointe en outre un choc social avec le contraste entre le personnage du père de la petite, riche et manipulateur, et celui du sourd-muet, miséreux et quasi-autiste. Dans cette société dépeinte, la violence s'infiltre partout, l'argent étant souvent le déclencheur de toute cette violence et cruauté. Le trafic d'organes règne, et, dans ce milieu dévasté et déshumanisant, la vengeance s'infiltre sans grande difficulté. Dans ses films, Park Chan-wook arrive toujours à saisir l'insécurité et le désœuvrement, laissant ses personnages livrés à eux-mêmes, abandonnant les dialogues pour donner aux gestes une plus grande violence et cruauté.  Enfin, il faut souligner les formidables interprétations de ce film. Si le cinéma de Park Chan-wook, si ciselé et maîtrisé soit-il, m'horrifie à chaque vision de ses films, on ne peut lui nier son talent pour la direction d'acteurs. Tout comme pour JSA ou Thirst, il y déploie son sens du trio, avec deux hommes et une femme. Le sourd-muet est interprété par Shin Ha-Kyun, un acteur fidèle qui jouait un second rôle dans JSA, et surtout le frère malade de Thirst, acteur dont la physionomie fragile sert toujours des personnages maladifs et nauséeux. Donna Bae, autre grand actrice qu'on retrouve dans The Host ou dans le rôle de la Air Doll de Kore-eda, sidère par sa nonchalance inquiétante. Et enfin Song Kang-ho, toujours aussi excellent, fait preuve d'une grande sobriété dans ce rôle de père incontrôlable, sobriété dramatique qu'il approfondira dans son rôle de prêtre avec Thirst.
Enfin, il faut souligner les formidables interprétations de ce film. Si le cinéma de Park Chan-wook, si ciselé et maîtrisé soit-il, m'horrifie à chaque vision de ses films, on ne peut lui nier son talent pour la direction d'acteurs. Tout comme pour JSA ou Thirst, il y déploie son sens du trio, avec deux hommes et une femme. Le sourd-muet est interprété par Shin Ha-Kyun, un acteur fidèle qui jouait un second rôle dans JSA, et surtout le frère malade de Thirst, acteur dont la physionomie fragile sert toujours des personnages maladifs et nauséeux. Donna Bae, autre grand actrice qu'on retrouve dans The Host ou dans le rôle de la Air Doll de Kore-eda, sidère par sa nonchalance inquiétante. Et enfin Song Kang-ho, toujours aussi excellent, fait preuve d'une grande sobriété dans ce rôle de père incontrôlable, sobriété dramatique qu'il approfondira dans son rôle de prêtre avec Thirst. 
 les landes perverses car désertiques de son pays natal, l'Andalousie, le jour où son frère se marie. A travers ce postulat sont dressés les deux thèmes principaux du film, à savoir le sens de la patrie et de la fratrie. Si l'action se passe en Andalousie, il se retrouve ce goût de la terre natale, des champs cultivés et d'anciennes traditions culinaires de la région, phase écologique que l'on peut difficilement soustraire à la majorité des films d'animation japonais. C'est peut-être à ce niveau que l'on retrouve le plus l'esprit de Miyazaki. Nasu donne une couleur dynamique à l'Andalousie, porté par les chansons typiques, les panoramiques sur les paysages, l'excentricité de ses habitants (tel l'oncle, un cas typique aussi agaçant qu'attachant), le symbole du taureau qui vient fournir de l'ombre au cycliste harassé.
les landes perverses car désertiques de son pays natal, l'Andalousie, le jour où son frère se marie. A travers ce postulat sont dressés les deux thèmes principaux du film, à savoir le sens de la patrie et de la fratrie. Si l'action se passe en Andalousie, il se retrouve ce goût de la terre natale, des champs cultivés et d'anciennes traditions culinaires de la région, phase écologique que l'on peut difficilement soustraire à la majorité des films d'animation japonais. C'est peut-être à ce niveau que l'on retrouve le plus l'esprit de Miyazaki. Nasu donne une couleur dynamique à l'Andalousie, porté par les chansons typiques, les panoramiques sur les paysages, l'excentricité de ses habitants (tel l'oncle, un cas typique aussi agaçant qu'attachant), le symbole du taureau qui vient fournir de l'ombre au cycliste harassé. 
 Je voulais parler de ce manga depuis longtemps, d’autant plus le huitième tome vient de paraître en librairie (toujours ce paradoxe entre le succès croissant de la bande dessinée japonaise dans notre pays et une publication française rare). Pandora Hearts de Jun Mochizuki est une version revisitée du mythique Alice aux Pays des Merveilles
Je voulais parler de ce manga depuis longtemps, d’autant plus le huitième tome vient de paraître en librairie (toujours ce paradoxe entre le succès croissant de la bande dessinée japonaise dans notre pays et une publication française rare). Pandora Hearts de Jun Mochizuki est une version revisitée du mythique Alice aux Pays des Merveilles  japonaise, notamment la question du passé et de la mémoire, qui hante chaque protagoniste. Le récit brasse avec un certain lyrisme l’action aux réflexions psychologiques des héros, les intrigues politiques au mystère des souvenirs morcelés d’Alice. Un fort symbolisme romantique agit tout au long des chapitres, tels les topoï de la rose, de la montre à gousset, de la mélodie familière, des jardins secrets, des évanescentes du passé… L’atout de Pandora Hearts est son scénario jouant sur la fragmentation, à l’image de la mémoire morcelée et incomplète d’Alice. Le mystère s’épaissit et se complexifie au fur et à mesure des chapitres, les indices étant délivrés par fragments, suggestions, visions fugitives sur le papier. L’ambiance joue aussi une importance capitale dans cette histoire, bardée de romantisme, d’onirisme envoûtant. Le trait est gracile et élégant, le découpage aéré et agréable, à la fois dépouillé et voluptueux lors des scènes de souvenirs, ou torturé et angoissant lors des introspections intérieures. Paradoxalement, si le mystère s’étoffe au fil des chapitres, le lecteur reste accroché, et le suspense se fait plus prenant, tout agissant sur la suggestion ou le souvenir, donc entretenant un doute constant jusqu’à ménager de grands moments dé révélation flamboyant. Il est ainsi assez plaisant de lire ce manga qui, loin des actions survoltées et grotesques de certains autres, laisse sa place à l’imagination du lecteur, grâce à son lyrisme empli de mystère et d’intrigues.
japonaise, notamment la question du passé et de la mémoire, qui hante chaque protagoniste. Le récit brasse avec un certain lyrisme l’action aux réflexions psychologiques des héros, les intrigues politiques au mystère des souvenirs morcelés d’Alice. Un fort symbolisme romantique agit tout au long des chapitres, tels les topoï de la rose, de la montre à gousset, de la mélodie familière, des jardins secrets, des évanescentes du passé… L’atout de Pandora Hearts est son scénario jouant sur la fragmentation, à l’image de la mémoire morcelée et incomplète d’Alice. Le mystère s’épaissit et se complexifie au fur et à mesure des chapitres, les indices étant délivrés par fragments, suggestions, visions fugitives sur le papier. L’ambiance joue aussi une importance capitale dans cette histoire, bardée de romantisme, d’onirisme envoûtant. Le trait est gracile et élégant, le découpage aéré et agréable, à la fois dépouillé et voluptueux lors des scènes de souvenirs, ou torturé et angoissant lors des introspections intérieures. Paradoxalement, si le mystère s’étoffe au fil des chapitres, le lecteur reste accroché, et le suspense se fait plus prenant, tout agissant sur la suggestion ou le souvenir, donc entretenant un doute constant jusqu’à ménager de grands moments dé révélation flamboyant. Il est ainsi assez plaisant de lire ce manga qui, loin des actions survoltées et grotesques de certains autres, laisse sa place à l’imagination du lecteur, grâce à son lyrisme empli de mystère et d’intrigues. Les personnages du manga s’avèrent assez bien nuancés, échappant à de nombreux lieux communs typiques des protagonistes de ce genre. Chacun se retrouvera en proie au doute selon les situations. Le personnage principal, Oz, jeune garçon volatile, gai comme un pinson et ayant un certain sens de l’opportunisme, révélera sa solitude par la suite. Alice, figure féminine très forte et tyrannique, oscille en permanence entre son côté féroce et la beauté de sa franchise. Gil, serviteur d’Oz, verra sa dévotion à son maître remise en cause par tous les autres protagonistes. Sharon, figure de jeune fille passionnée, révèle une sagesse infinie. Break, un des personnages les plus populaires de la série au Japon, est une sorte de Chapelier Fou charmant et inquiétant, tentant de dominer les situations par son comportement cynique. Mais un autre personnage me semble le plus tragique et complexe, c'est celui, empreint d'héroïsme, d'Eliot Nightray, sorte d'incarnation nostalgique de certaines valeurs perdues comme l'honneur, la fierté du nom, le sens chevaleresque et de l'amitié. Ce personnage, dont l'apparition semble hasardeuse au début, se connecte progressivement à l'immense toile d'araignée qu'est l'intrigue de la tragédie de Sabrié (événement mystique et apocalyptique autour duquel planent tous les souvenirs disparus), et se retrouve précipité dans un destin tragique avec son serviteur Leo, par ailleurs lui aussi un personnage très ambivalent.
Les personnages du manga s’avèrent assez bien nuancés, échappant à de nombreux lieux communs typiques des protagonistes de ce genre. Chacun se retrouvera en proie au doute selon les situations. Le personnage principal, Oz, jeune garçon volatile, gai comme un pinson et ayant un certain sens de l’opportunisme, révélera sa solitude par la suite. Alice, figure féminine très forte et tyrannique, oscille en permanence entre son côté féroce et la beauté de sa franchise. Gil, serviteur d’Oz, verra sa dévotion à son maître remise en cause par tous les autres protagonistes. Sharon, figure de jeune fille passionnée, révèle une sagesse infinie. Break, un des personnages les plus populaires de la série au Japon, est une sorte de Chapelier Fou charmant et inquiétant, tentant de dominer les situations par son comportement cynique. Mais un autre personnage me semble le plus tragique et complexe, c'est celui, empreint d'héroïsme, d'Eliot Nightray, sorte d'incarnation nostalgique de certaines valeurs perdues comme l'honneur, la fierté du nom, le sens chevaleresque et de l'amitié. Ce personnage, dont l'apparition semble hasardeuse au début, se connecte progressivement à l'immense toile d'araignée qu'est l'intrigue de la tragédie de Sabrié (événement mystique et apocalyptique autour duquel planent tous les souvenirs disparus), et se retrouve précipité dans un destin tragique avec son serviteur Leo, par ailleurs lui aussi un personnage très ambivalent.  page étant une délectation des yeux, les illustrations peintes de l'auteur étant particulièrement belles. Les personnages sont de plus tous attachants, car tous mystérieux et échappant aux habituels lieux communs des héros typés de nombreux mangas. Au fil des chapitres, la dimension tragique s'intensifie, et certains passages s'assimilent à une véritable catharsis visuelle. Jun Mochizuki réussit à imprimer visuellement, par des découpages parfois violents et un travail typographique brutalisé (mais loin de tomber dans le gore ou l'horrifique, c'est là toute la qualité de son oeuvre qui conserve en permanence une certaine élégance) la torpeur psychologique de ses personnages, souvent dans l'incompréhension face à l'immensité de ce qui les dépasse. Difficile de comprendre, dans ces passages, quel est le véritable objet de leur peur, le mystère confinant parfois jusqu'à l'abstraction, et pourtant, l'impression s'en retrouve fortifiée et intensifiée, déchirante et troublante.
page étant une délectation des yeux, les illustrations peintes de l'auteur étant particulièrement belles. Les personnages sont de plus tous attachants, car tous mystérieux et échappant aux habituels lieux communs des héros typés de nombreux mangas. Au fil des chapitres, la dimension tragique s'intensifie, et certains passages s'assimilent à une véritable catharsis visuelle. Jun Mochizuki réussit à imprimer visuellement, par des découpages parfois violents et un travail typographique brutalisé (mais loin de tomber dans le gore ou l'horrifique, c'est là toute la qualité de son oeuvre qui conserve en permanence une certaine élégance) la torpeur psychologique de ses personnages, souvent dans l'incompréhension face à l'immensité de ce qui les dépasse. Difficile de comprendre, dans ces passages, quel est le véritable objet de leur peur, le mystère confinant parfois jusqu'à l'abstraction, et pourtant, l'impression s'en retrouve fortifiée et intensifiée, déchirante et troublante. 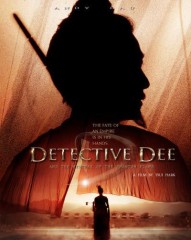
 Histoire et divertissement
Histoire et divertissement autour du thème du feu, mais rejoint aussi une gamme de couleurs chaudes propres à l'Impératrice. Doré des costumes, rouge des capes qui claquent, orange des bannières qui volent. Tout un imaginaire chinois est retrouvé dans ce film, à travers une intrigue inexplicable et des phénomènes mystiques peu à peu supplantés par l'explication scientifique (les corps qui brûlent, l'apparition du prêtre sous forme d'un cerf). Ceci rappelle la méthode de Sherlock Holmes. Cependant, si le scénario du film de Guy Ritchie était d'une simplicité et d'un conventionnalisme déconcertants, Détective Dee réussit à captiver. Car le protagoniste principal n’est pas le seul à tendre ses efforts vers la résolution. D'autres, motivés par diverses raisons, font preuve d'autant intelligence et ruse, émettent des hypothèses, devancent le détective ou entravent son parcours. Le personnage de l'albinos (qui a par ailleurs conquis pas mal de cœurs féminins à la sortie du film...) en est l'exemple, dont la quête est aussi passionnante que celle de Dee. Ce dernier suit ainsi un parcours tortueux avant d'accéder à la vérité, dérouté par de multiples rebondissements, attaques, ou entraîné par de fausses pistes (celle du poison dans la gourde, explication qui semble évidente de prime abord, sertie par de gros plans trompeurs sur l'objet)
autour du thème du feu, mais rejoint aussi une gamme de couleurs chaudes propres à l'Impératrice. Doré des costumes, rouge des capes qui claquent, orange des bannières qui volent. Tout un imaginaire chinois est retrouvé dans ce film, à travers une intrigue inexplicable et des phénomènes mystiques peu à peu supplantés par l'explication scientifique (les corps qui brûlent, l'apparition du prêtre sous forme d'un cerf). Ceci rappelle la méthode de Sherlock Holmes. Cependant, si le scénario du film de Guy Ritchie était d'une simplicité et d'un conventionnalisme déconcertants, Détective Dee réussit à captiver. Car le protagoniste principal n’est pas le seul à tendre ses efforts vers la résolution. D'autres, motivés par diverses raisons, font preuve d'autant intelligence et ruse, émettent des hypothèses, devancent le détective ou entravent son parcours. Le personnage de l'albinos (qui a par ailleurs conquis pas mal de cœurs féminins à la sortie du film...) en est l'exemple, dont la quête est aussi passionnante que celle de Dee. Ce dernier suit ainsi un parcours tortueux avant d'accéder à la vérité, dérouté par de multiples rebondissements, attaques, ou entraîné par de fausses pistes (celle du poison dans la gourde, explication qui semble évidente de prime abord, sertie par de gros plans trompeurs sur l'objet)
 Dee
Dee  d'autant plus que les personnages s'avèrent assez finement travaillés. Une bonne partie des stars de cinéma en Chine sont d'excellents acteurs (contrairement à une bonne pléiade d'acteurs français renommés...). Andrew Lau, l'heureux réalisateur d'I
d'autant plus que les personnages s'avèrent assez finement travaillés. Une bonne partie des stars de cinéma en Chine sont d'excellents acteurs (contrairement à une bonne pléiade d'acteurs français renommés...). Andrew Lau, l'heureux réalisateur d'I