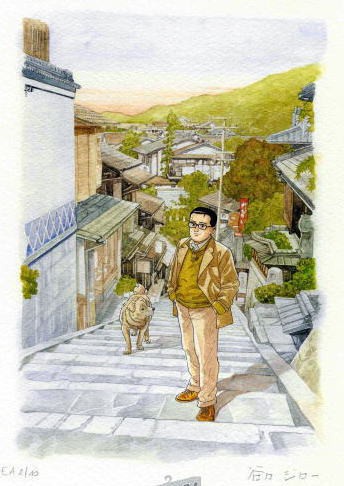RUNNING OUT OF TIME (1999) et MAD DETECTIVE (2008)
Deux films de Johnnie To


Bien représentatifs de l'efficacité du maître hong-kongais, Running out of Time (1999) et Mad Detective (2008, co-réalisé avec Wai Ka Fay) pourraient être des chefs d'oeuvre s'il n'y manquait pas un petit quelque chose qui les amèneraient au même rang que l'époustouflant Exilé, à ce jour l'un des meilleurs films de Johnny To, et pourtant l'un des plus méconnus. Ils incarnent cependant tous deux la fantaisie violente du cinéma du réalisateur, combinant un scénario haletant, s'amusant à suivre tout autant à démonter les codes du genre et de conserver un rythme effréné, et un souci de mettre en situation des personnages à demi-fous. Ces deux films confirment une certaine efficacité dans le style, bien loin de la vision politico-guerrière mise en oeuvre dans le dyptique d'Election, insoutenable et étouffant.
L'une des raisons de la réunion de ces films dans cette critique est son acteur commun, le génial Lau Ching-wan. n'hésitant pas à frôler l'autodérision, notamment pour le protagoniste de Mad Detective, l'acteur se retrouve face à deux rôles très différents. Dans l'un, il incarne le pilier fondateur de l'intrigue, sa vision s'accordant au champ de la caméra, brouillant la frontière entre réalité et subjectivité gagnée par la folie et la paranoïa, ce qui en constitue un caractère tragiquement désuet. Dans l'autre, il soutient le personnage incarné par Andrew Lau (le futur mafieux infiltré dans la police et co-réalisateur d'Infernal Affairs), se prêtant à un rôle plus léger, dans le but d'organiser un jeu complice avec son partenaire, atteint d'un cancer en phase terminale. Pourtant, là où Running Out of Time pouvait se prêter aisément au mélodrame obscur, le film se révèle léger et dynamique, jouant sur l'antagonisme de ses deux personnages.
Le thème de l'affrontement final et massif se retrouve ainsi dans Running Out of time, à travers la confrontation entre les deux acteurs, l'un marqué par la tragédie, l'autre par la joie de vivre. Leurs visages mêmes s'opposent : Lau Ching-wa est d'un physique volontiers bonhomme et sympathique, tandis que la beauté efféminée et encore jeune de Andrew Lau le pose comme quelqu'un de fragile. Cependant, là où l'on aurait pu attendre dans cette course-poursuite que le plus dynamique soit le chat, l'inverse se produit : c'est la malade qui se révèle le plus redoutable et machiavélique, n'hésitant pas à piéger son adversaire, qui prend un certain plaisir à jouer les complices de sa propre destruction. Le héros de Johnnie To sont toujours si curieux qu'ils n'hésitent pas à se lancer dans l'inconnu et dans le risque. Ainsi, si Running Out of Time imprime le thème de la confrontation, Mad Detective concerne plus un duel introspectif. L'ancien inspecteur incarné par un Lau Ching-wa bien plus dramatique, s'enfonce dans sa propre folie pour lever le voile sur la mystère des autres.


Le double joue ainsi un rôle majeur dans Mad Detective, alors que c'est le temps qui marque Running Out of Time. Johnnie To se plaît à utiliser des caractéristiques psychologique sou de concepts abstraits pour les incarner en permanence dans sa mise en scène et dans la construction dramatique du récit. Dans l'un, le détective voit les 7 personnalités du suspect, créées grâce à un artifice classique de montage (le raccord-regard sur l'homme surveillé sifflant un air/puis sur le détective l'observant hors-champ/pour découvrir, dans un troisième plan, 7 nouvelles personnes continuant de siffler le même air à la place du suspect), dans l'autre, la bombe est à la fois une menace et un moyen d'égrener le temps qu'il reste au malade. les idées de mise en scène se multiplient, les films jouant ou déjouant les attentes, utilisant jusqu'au bout les possibilités ouvertes par le thème. Le final de Mad Detective est ainsi flamboyant, et ce, malgré une présence convenue des miroirs dans ce drame psychologique : tous reflètent à la fois la réalité, la folie, la subjectivité du personnage, et éclatent au rythme des balles et des révélations. Quant à Running Out of Time, ses bombes n'explosent jamais, contre toute attente, tout moyen est bon pour s'infiltre dans la course : les pas claquent dans les escaliers, certains rampent dans les conduits d'aération, les voitures se bousculent, et les deux ennemis finissent par se retrouver coincés l'un contre l'autre entre deux portières lors d'un échange de tirs intensif.


Les personnages restent empreints d'un soupçon de fantaisie, ce qui rajoute du charme à ces deux films et les distingue d'un banal film d'action. Dans Running Out of Time, Lau Ching-wa est un négociateur volatile et nonchalant, sorte de Patrick Jane attendri par ses subordonnés et mesquin envers son supérieur ridicule. Il faut aussi compter sur la présence de Suet Lam dans ce film, un second rôle très récurrent chez Johnnie To, notamment parce qu'il comporte ce faciès mémorable du lourdaud patibulaire, ce que l'acteur joue avec une belle efficacité. Quant à Andrew Lau, si son interprétation a moins de densité que dans Infernal Affairs (notamment en raison de son plus jeune âge), les belles scènes de complicité mises en oeuvre avec Lau Ching-wa permettent de relever son niveau. Lau Ching-wa, immense acteur qui s'illustre dans les deux films, incarne ainsi le personnage fou de Mad Detective, un homme prêt à subir toutes les épreuves pour ressentir physiquement les détails de l'enquête, comme se faire jeter enfermé dans une valise depuis le haut d'un escalier, ou s'enterrer pendant toute une nuit sous la terre. Ce personnage représente bien l'humour noir et morbide qui s'imprime dans les films de Johnnie To, qu'ils soient légers ou violents. L'homme offre une oreille en guise de cadeau d'adieu à son supérieur qui prend sa retraite, toujours balancé entre le sérieux du sacrifice et l'absurdité des gestes de mutilation. Si ces deux films offrent leur lot de personnages incongrus, il y manque cependant un adversaire excentrique et à la hauteur des héros. Il n'y a par exemple pas de folie joviale comme celle déployée par le mafieux incarné par Simon Yam (assurément l'un des meilleurs interprètes de méchants dans le cinéma d'action d'aujourd'hui) dans Exilé ou Vengeance. Les ennemis à contrecarrer restent malheureusement en-deçà de la mise en scène et des interprètes principaux.


Les deux films s'aventurent de plus sur le chemin de l'urbanité et de la nuit. La ville nocturne est toujours primordiale dans la filmographie de Johnny To, que ce soient les environs d'Hong-Kong ou de Macao. Un des films les plus connus du cinéaste imprime très bien cette passion : PTU, suivant les circonvolutions de divers protagonistes durant toute une nuit dans les rues. Les personnages errent au milieu des avenues désertes, les paysages étant proches des landes d'un western par leur désolation, leur mystère amenant les êtres à se méfier des alentours ou d'eux-mêmes. C'est souvent dans une rue déserte que les hommes se retrouvent face à la solitude et au drame dans Johnnie To, et les deux films n'échappent pas à la règle.
Enfin, si le cinéma de To s'impose comme marqué par sa masculinité, la femme n'en est pas pour autant écartée et y joue toujours un rôle primordial, souvent tendre ou déclencheur (hé oui, si la rédactrice de cette critique n'est pas insensible au charme des comédiens masculins des films de Johnny To, elle ne soutiendra jamais un film qui ne défend pas la femme d'une manière ou d'une autre). Dans Running out of time, le personnage féminin est de passage et s'avère la seule esquisse d'une jolie intrigue sentimentale avec le malade poursuivi par la police. Dans Mad Detective, il acquiert une importance capitale dans la folie du personnage : la femme interprétée par Kelly Lin s'avère une chimère, un souvenir désiré et construit d'après les photographies, que l'homme soumet aux autres qui jouent le jeu en acceptant son existence fantôme. le film crée ainsi une belle parabole sur l'amour perdu et désiré, sur la permanence d'une image fantasmée mais irréelle.
Moins intensifs ou flamboyants par rapport à Exilé ou Election, ces deux films de Johnny To s'avèrent cependant excellents par leur sens du rythme, leur habile scénario combiné à une mise en scène toujours en recherche d'originalité et de trouvailles, et surtout leurs interprètes fascinants.
 L'excellent dernier film de Tsui Hark, en salles durant avril dernier, vient déjà de sortir en DVD et Blu-ray. Une injustice se pointe déjà, récurrence sur le marché et stratégie commerciale pour pousser le public français à acheter des lecteurs Blu-rays : l'édition BD contient trois fois plus de bonus qu'une édition DVD bien décevante et simple (pas de making-of, ni d'entretiens avec le réalisateur ou les comédiens). Le fort travail de reconstitution et de restitution de l'Histoire, de même que les effets spéciaux desservant des idées monumentales de mises en scène, donnent pourtant matière à réflexion et explication dans ce film. On aurait pu souhaiter des bonus techniques et des interviews d'historiens sur le sujet...
L'excellent dernier film de Tsui Hark, en salles durant avril dernier, vient déjà de sortir en DVD et Blu-ray. Une injustice se pointe déjà, récurrence sur le marché et stratégie commerciale pour pousser le public français à acheter des lecteurs Blu-rays : l'édition BD contient trois fois plus de bonus qu'une édition DVD bien décevante et simple (pas de making-of, ni d'entretiens avec le réalisateur ou les comédiens). Le fort travail de reconstitution et de restitution de l'Histoire, de même que les effets spéciaux desservant des idées monumentales de mises en scène, donnent pourtant matière à réflexion et explication dans ce film. On aurait pu souhaiter des bonus techniques et des interviews d'historiens sur le sujet...
 Magnetic Rose de Koji Morimoto
Magnetic Rose de Koji Morimoto et le récit dans l'absurde et le grinçant, qui montre comment un jeune homme ayant avalé par inadvertance un médicament contre son rhume se révèle être une bombe puante détruisant toute forme de vie à vingt mètres, ne suffisent pas à apporter l'originalité dans l'ensemble. Un banal récit caricatural voulant mettre en lumière l'incapacité des autorités face à l'événement, mais qui fait au final plus sourire que réfléchir, d'autant plus que l'animation est d'un classicisme fade.
et le récit dans l'absurde et le grinçant, qui montre comment un jeune homme ayant avalé par inadvertance un médicament contre son rhume se révèle être une bombe puante détruisant toute forme de vie à vingt mètres, ne suffisent pas à apporter l'originalité dans l'ensemble. Un banal récit caricatural voulant mettre en lumière l'incapacité des autorités face à l'événement, mais qui fait au final plus sourire que réfléchir, d'autant plus que l'animation est d'un classicisme fade.  Cannon Folder de Katsuhiro Otomo
Cannon Folder de Katsuhiro Otomo


 la jeune fille qu'il assomme dans son bus avant de l'achever chez lui). Par ailleurs, cette attitude presque spectatrice chez lui (comme quand il demande à la secrétaire du médecin de se déshabiller, et se contente de soupirer et de lui lancer des objets quand elle est trop lente, comme il aurait pu le faire dans une mauvaise représentation théâtrale), l'importance des références cinématographiques dans ses actes (ainsi, quand il surgit de la droite de l'écran lors du premier meurtre, à la manière du tueur de Memories of Murder qui surgit sur le chemin lors d'un de ses assassinats), laissent à penser qu'il s'est construit cette identité de tueur comme spectateur, comme quelqu'un qui, abreuvé de films de genre et de récits glauques, aurait décidé, lui aussi, d'embrasser la carrière de serial killer : d'où, là encore, sa tranquille jubilation quand il trouve comment berner Soo-hyun. C'est probablement ce qui fait de J'ai rencontré le diable un grand, un très grand film : un personnage si ambigü, si fascinant, interprété par un acteur de génie. Et si Lee Byung-hun est tout aussi excellent en homme assoiffé de vengeance, c'est avant tout Choi Min-sik qui reste dans les esprits, dans le rôle d'un des plus grands tueurs de l'histoire du cinéma.
la jeune fille qu'il assomme dans son bus avant de l'achever chez lui). Par ailleurs, cette attitude presque spectatrice chez lui (comme quand il demande à la secrétaire du médecin de se déshabiller, et se contente de soupirer et de lui lancer des objets quand elle est trop lente, comme il aurait pu le faire dans une mauvaise représentation théâtrale), l'importance des références cinématographiques dans ses actes (ainsi, quand il surgit de la droite de l'écran lors du premier meurtre, à la manière du tueur de Memories of Murder qui surgit sur le chemin lors d'un de ses assassinats), laissent à penser qu'il s'est construit cette identité de tueur comme spectateur, comme quelqu'un qui, abreuvé de films de genre et de récits glauques, aurait décidé, lui aussi, d'embrasser la carrière de serial killer : d'où, là encore, sa tranquille jubilation quand il trouve comment berner Soo-hyun. C'est probablement ce qui fait de J'ai rencontré le diable un grand, un très grand film : un personnage si ambigü, si fascinant, interprété par un acteur de génie. Et si Lee Byung-hun est tout aussi excellent en homme assoiffé de vengeance, c'est avant tout Choi Min-sik qui reste dans les esprits, dans le rôle d'un des plus grands tueurs de l'histoire du cinéma.





 Stanley Kwan est un réalisateur chinois s'étant fait remarquer durant les années 1990. Il tourne encore aujourd'hui quelques films, malheureusement difficilement trouvables. Stanley Kwan a notamment réalisé un film assez célèbre dans un certain cinéma indépendant de Chine, Lan Yu, histoire d'hommes à Pékin, qui fait parti de ces films fiévreux et intimiste parlant de l’homosexualité en Chine au même titre que Happy Together de Wong Kar-wai ou Nuits d'ivresse printanière de Lou Ye. Metropolitan Film Export vient tout juste de sortir un très beau coffret dédié à trois œuvres de Stanley Kwan, portées par de grands acteurs faisant leurs débuts, tels Maggie Cheung, Carina Lau, Tony Leung ou Leslie Cheung.
Stanley Kwan est un réalisateur chinois s'étant fait remarquer durant les années 1990. Il tourne encore aujourd'hui quelques films, malheureusement difficilement trouvables. Stanley Kwan a notamment réalisé un film assez célèbre dans un certain cinéma indépendant de Chine, Lan Yu, histoire d'hommes à Pékin, qui fait parti de ces films fiévreux et intimiste parlant de l’homosexualité en Chine au même titre que Happy Together de Wong Kar-wai ou Nuits d'ivresse printanière de Lou Ye. Metropolitan Film Export vient tout juste de sortir un très beau coffret dédié à trois œuvres de Stanley Kwan, portées par de grands acteurs faisant leurs débuts, tels Maggie Cheung, Carina Lau, Tony Leung ou Leslie Cheung.  désoeuvrés, gaspillant le meilleur de leur temps dans des amours malheureux et de nombreuses beuveries insensées. A travers ce film à la fois maladroit et intense, Stanley Kwan exprime toute la frustration d'une certaine jeunesse, désabusée et peinant à maintenir ses illusions, en proie à une solitude terrible, tout en dressant un portrait d'une Chine aux multiples visages. Le héros principal, incarné par un Tony Leung tout jeunot, doit reprendre le commerce de riz de son père, enfermé dans une logique de succession familiale. Les femmes qu'il rencontre proviennent de Taïwan, venues à la recherche du luxe et de la vie urbaine rêvée dans les bars du soir et les karaokés, mais traînent leurs longues jambes avec désinvolture, lassitude. Ces personnages, dans un premier temps, gravitent les uns autour des autres, entre fêtes d'anniversaires, soirées, visites d'appartement. Stanley Kwan les filme avec cette distance discrète et cette observation respectueuse, ne jugeant pas leur paresse et mollesse, approchant quelques détails de l'intimité. La chanteuse de karaoké qui se retourne au milieu de sa chanson pour pleurer. Une autre qui évite la question « As-tu déjà avortée ». Une dernière qui se cache derrière ses lunettes de soleil pour esquiver les confrontations. Et Tony Leung qui observe ces femmes, les admire par leur désinvolture et leur humour, également attiré par les miroitements de leur appartement luxueux et leur mode de vie désintéressé.
désoeuvrés, gaspillant le meilleur de leur temps dans des amours malheureux et de nombreuses beuveries insensées. A travers ce film à la fois maladroit et intense, Stanley Kwan exprime toute la frustration d'une certaine jeunesse, désabusée et peinant à maintenir ses illusions, en proie à une solitude terrible, tout en dressant un portrait d'une Chine aux multiples visages. Le héros principal, incarné par un Tony Leung tout jeunot, doit reprendre le commerce de riz de son père, enfermé dans une logique de succession familiale. Les femmes qu'il rencontre proviennent de Taïwan, venues à la recherche du luxe et de la vie urbaine rêvée dans les bars du soir et les karaokés, mais traînent leurs longues jambes avec désinvolture, lassitude. Ces personnages, dans un premier temps, gravitent les uns autour des autres, entre fêtes d'anniversaires, soirées, visites d'appartement. Stanley Kwan les filme avec cette distance discrète et cette observation respectueuse, ne jugeant pas leur paresse et mollesse, approchant quelques détails de l'intimité. La chanteuse de karaoké qui se retourne au milieu de sa chanson pour pleurer. Une autre qui évite la question « As-tu déjà avortée ». Une dernière qui se cache derrière ses lunettes de soleil pour esquiver les confrontations. Et Tony Leung qui observe ces femmes, les admire par leur désinvolture et leur humour, également attiré par les miroitements de leur appartement luxueux et leur mode de vie désintéressé. 
 d'humour dans le drame agissant et étant le catalyseur de toutes les frustrations. Chow Yun-fat fait des exercices de gymnastique en plein interrogatoire, revient sur les lieux du crime par curiosité et surprend une scène d'amour, imite Columbo et finit par échanger une soirée arrosée avec ceux qu'ils surveillent. Par lui, le spectateur s'introduit dans l'intimité de ces jeunes gens, dont les désirs affleurent, les angoisses se montrent, les lunettes craquent. A la fin, il ne reste plus que des regrets, des souffrances, des résidus d'avortement. Comme le personnage de Chow Yun-fat qui avoue avoir approché les jeunes gens juste pour les voir gaspiller leur vie, le spectateur a partagé ces Love Unto Wastes, ces amours déchus, ces vies consommées par le plaisir, incapables de retrouver le plaisir et leur place, brisées et délaissées. Le film dénonce cette solitude d'une certaine jeunesse, isolée dans la société, ne pouvant pas s'intégrer socialement et étant quasiment oubliée. Seul cet inspecteur de police, parce qu'il connaît d'autres souffrances depuis le départ de sa femme, s'intéresse à eux, se retrouve dans leur solitude. Les marginaux se retrouvent et si ce très beau film laisse une trace d'amertume et de regrets, il laisse percer à la fin la possibilité d'une amitié entre ces êtres désoeuvrés.
d'humour dans le drame agissant et étant le catalyseur de toutes les frustrations. Chow Yun-fat fait des exercices de gymnastique en plein interrogatoire, revient sur les lieux du crime par curiosité et surprend une scène d'amour, imite Columbo et finit par échanger une soirée arrosée avec ceux qu'ils surveillent. Par lui, le spectateur s'introduit dans l'intimité de ces jeunes gens, dont les désirs affleurent, les angoisses se montrent, les lunettes craquent. A la fin, il ne reste plus que des regrets, des souffrances, des résidus d'avortement. Comme le personnage de Chow Yun-fat qui avoue avoir approché les jeunes gens juste pour les voir gaspiller leur vie, le spectateur a partagé ces Love Unto Wastes, ces amours déchus, ces vies consommées par le plaisir, incapables de retrouver le plaisir et leur place, brisées et délaissées. Le film dénonce cette solitude d'une certaine jeunesse, isolée dans la société, ne pouvant pas s'intégrer socialement et étant quasiment oubliée. Seul cet inspecteur de police, parce qu'il connaît d'autres souffrances depuis le départ de sa femme, s'intéresse à eux, se retrouve dans leur solitude. Les marginaux se retrouvent et si ce très beau film laisse une trace d'amertume et de regrets, il laisse percer à la fin la possibilité d'une amitié entre ces êtres désoeuvrés.