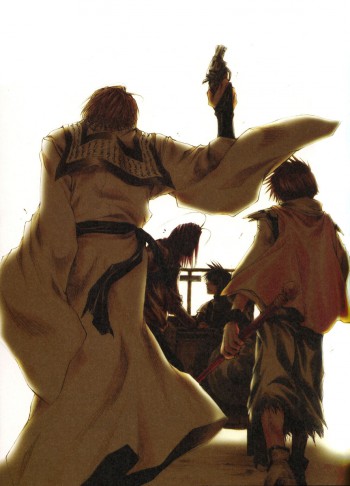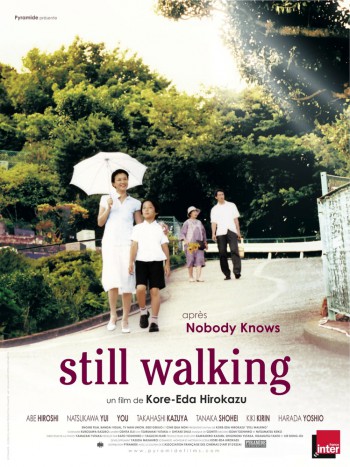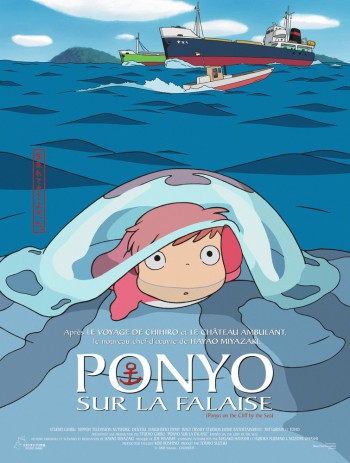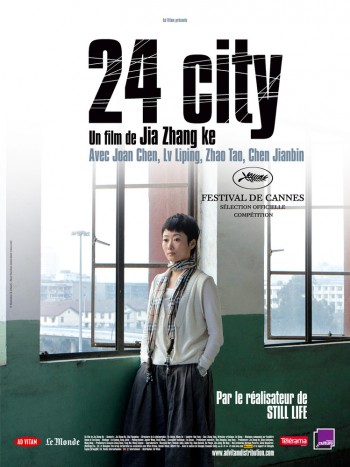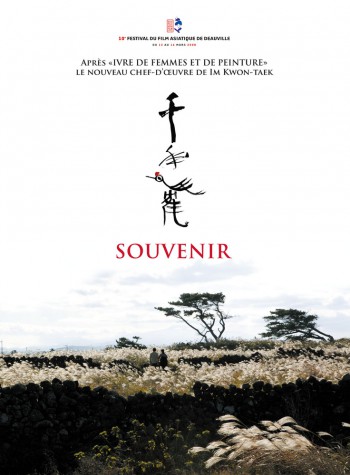Suis-moi je te fuis / Fuis-moi je te suis
Vengeance
L'étranger de Macau
VENGEANCE (2009) – Johnny To

J'avoue qu'à la vue d'une affiche hautement hideuse mettant en avant Johnny Halliday, je me suis demandée ce qui était arrivé à Johnny To. On pourrait croire que Vengeance vise uniquement à mettre en valeur le star française dans une production étrangère et la glorifier par le biais d'un film d'action. Heureusement, dès les premières images, le style de Johnny To et de son scénariste Wai Ka-Fai s'impose, nous livrant une fois de plus une oeuvre divertissante et efficace, certes moins impressionnante que Exilé, mais restant dans l'optique de ses thèmes habituels.

La Vengeance de ce Français, Costello, incarné par Halliday, n'est qu'un prétexte pour introduire les personnages typiques chers à Johnny To : un trio de tueurs à gages professionnels qui vont peu à peu s'affranchir du grand patron, machiavélique et impulsif à souhait, et ce à travers de multiples scènes d'action époustouflantes. Les similitudes avec Exilé, voire Sparrow, sont nombreuses. Tout d'abord, les mêmes acteurs sont à l'honneur, permettant de perfectionner leur jeu, notamment Simon Yam, déjà hilarant dans Sparrow, qui joue le rôle d'un patron de gang proche de celui d'Exilé en beaucoup plus décadent, mais malheureusement mis à l'honneur. Autre racine, le fameux trio contestataire, élaborant des stratégies réfléchies et une attitude classe, marqué par le soulèvement d'indépendance. Il est même doublé, retrouvant un reflet exact en les personnes des tueurs de la famille de Costello, réaffirmant les « types » de personnages que le cinéaste se plaît à traiter, ce qui donne lieu à une confrontation impressionnante.

Johnny Halliday, face à ces acteurs expérimentés et parfaitement intégrés à l'univers de Johnny To, fait pâle figure, s'appuyant sur un registre monolithique grave et peu nuancé. La démarche du réalisateur vis à vis de l'acteur français comporte néanmoins son intérêt. Autant Halliday n'est pas habitué à jouer dans une production asiatique, autant ce décalage se ressent au niveau de son personnage. En effet, Frank Costello/Halliday est totalement inconnu, étranger aux éléments du récit et du film lui-même, ce qui explique son jeu hagard, hésitant et sa lourdeur. Il ne comprend absolument rien aux codes de la mafia de Macau, aux actions du groupe qu'il a engagé, n'agissant qu'à partir de quelques mots écrits en vitesse sur une photographie tandis que ceux qui l'entourent – les habitués de To – élaborent des stratégies complexes et intelligentes. Le contratse s'affirme ainsi entre ces quatre tueurs à gages, charismatiques, sûrs d'eux, même face à la mort, qu'ils affrontent dans une bataille impressionnante d'éclat ; et Costello, agissant à l'aveuglette, se laissant prendre à tous les pièges dressés par les protagonistes du lieu. Aux stratégies, plans construits de manière absurde mais efficace par les personnages-clés du cinéaste (comme les étiquettes vendues par les enfants et collées sur le grand patron pour l'identifier) s'oppose l'action brute et irréfléchie de l'étranger de Macau.

Certes, Vengeance est bien moins subtil et cruel qu'Exilé, bien moins énergique (notamment dans le scénario, assez banal et équilibré) et original que Sparrow, mais il confirme le talent de Johnny To pour l'orchestration des scènes d'action, et définit ses thèmes fétiches, néanmoins moins riches (comme le personnage de Kwai, leader du trio qui méritait plus d'importance). Cependant, To réussit à utiliser de manière relativement efficace et intelligente la présence de cet acteur européen qu'il ne désirait pas à la base (il exigeait Alain Delon), le traitant comme un parfait étranger en tant que personnage et acteur.