Kaïro (2001) - Kiyoshi Kurosawa
Une critique de Big-Cow

Je suis tombé par hasard sur Kaïro, hier, sur Arte ; le film était curieusement diffusé après Citizen Kane, et je me suis un temps demandé comment Arte organisait sa programmation, avant de me rendre compte qu'il s'agissait d'un Kurosawa et que ce réalisateur faisait défaut dans ma culture cinématographique. On parle du Kurosawa de Jellyfish, ici, et je tiens à préciser que je suis également assez peu familier des codes de l'horreur à l'asiatique, les rares films que j'ai vu de ce côté tapant davantage du côté du slasher ; je ne connais des films d'horreur japonais guère que les influences qu'ils ont en Occident sur des jeux vidéo tels que F.E.A.R., par exemple, et ce même si j'ai eu l'occasion de lire quelques mangas horrifiques (Minetaro Mochizuki, Junji Ito).
Rien toutefois de très déstabilisant, de très surprenant dans Kaïro. Le rythme du film est très lent, et Kurosawa joue beaucoup sur une ambiance pesante, aride, malsaine, ça et là rythmée par quelques apparitions, mais jamais rien de soudain. Le travail sur le son, sur les arrière-plans et les premiers plans, est très intéressant, donne lieu à quelques grands moments assez tendus. Mais de là à dire que Kaïro est effrayant ? Non, le film est de facture trop classique, son intrigue trop décousue, pour qu'on arrive vraiment à se passionner pour le sort de ses personnages (par ailleurs quelque peu transparents). Le travail esthétique, lugubre à souhait, attire davantage l'attention du spectateur que l'histoire ici racontée.

De quoi ça parle d'ailleurs ? D'apparitions de fantômes, de suicides, de disparitions, de bâtiments abandonnés. Avec un vecteur : Internet. On est en 2001, en plein grand boom des terreurs urbaines liées à Internet, et un programme se lance sur de nombreux ordinateurs, faisant défiler aux yeux des utilisateurs des images, parfois passées en boucle, de personnages immobiles, dans l'ombre, dans leurs appartements ; peut-être des fantômes, peut-être des vivants, en tout cas filmés dans une qualité exécrable, crasse, malsaine. On a une sorte d'effroi rampant, latent, qui se répand d'écran en écran, d'utilisateur en utilisateur, au fur et à mesure que ceux-ci essayent de comprendre ce qu'ils voient, essayent pour certains d'aller plus loin dans le visionnage de vidéos, pour d'autres d'y mettre fin. Dix ans après, Kaïro a indéniablement vieilli : comme beaucoup, si j'ai conscience de l'existence sur la toile de recoins obscurs et terrifiants où naissent slashers et histoires de fantôme (Luka Rocco Magnotta nous l'a récemment rappelé), je vois Internet davantage comme l'immense royaume du LOL et de la culture. Avoir peur d'Internet, en 2012 ? Bitch, please ! Les dialogues ("Internet Explorer ? Attends, je n'y connais rien en informatique, de quoi tu parles ?"), le bruitage permanent du modem, les artifices horrifiques aujourd'hui vus et revus (appel à l'aide par un fantôme au téléphone, connection au site Internet se faisant sans que personne ne touche à l'ordinateur), sonnent déjà faux. Reste la mise en scène de Kurosawa, encore susceptible d'éveiller l'angoisse, ainsi qu'un certain intérêt sociologique et historique pour un film d'horreur un peu dépassé mais qui reflète les peurs liées aux grands débuts de l'Internet grand public. Je tiens à préciser que je ne parle pas ici de la dernière demie-heure du film, assez singulière et que je trouve personnellement assez réussi, mais qui change quelques peu les codes du film et qui m'amènerait à de lourds spoils.

Regarder Kaïro m'a toutefois amené à réfléchir sur les lieux où se passait le film (et il y aura de légers spoils dans la suite, mais légers, hein : toujours rien sur la fin du film). La très grande majorité de Kaïro, en tout cas la très grande majorité des scènes horrifiques, se déroulent dans des appartements. Essayant de brasser mes références en matière d'horreur, il est vrai que j'ai eu quelques difficultés à retrouver des oeuvres reprenant ce type de lieu comme base de l'horreur. Dans le domaine du jeu vidéo, à part peut-être si l'on regarde du côté du jeu vidéo indépendant, un espace de la taille d'un appartement n'offrirait pas un espace suffisant au jeu pour qu'il s'y déroule vraiment quelque chose. Au cinéma, j'ai songé à La Horde de Yannick Dahan, à Attack the Block de Joe Cornish (un poulain du génialissime Edgar Wright), ou au remarquable Candyman de Bernard Rose, qui exploitent les espaces offerts par des appartements de banlieue : toutefois, le choix du lieu est ici principalement motivé par les réflexions sociales plus ou moins développées par les films en question (c'est particulièrement net pour Candyman, qui tient pour beaucoup d'un film sur la ségrégation spatiale). L'appartement japonais (ou asiatique de manière générale) est composé d'une ou deux pièces, étriqué, mal éclairé, étroit, glauque, les protagonistes y vivent seuls, isolés. Le lieu se prête a priori mal à la matière filmique : pas de possibilité de déplacer les personnages, unité de lieu. Toutefois, le personnage de Harué, en évoquant l'isolement que les personnages connaissent dans ces appartements, met le doigt sur ce qui fait des appartements des lieux terrifiants pour les protagonistes : on y est seul, on y vit seul. Ce n'est pas un lieu où on rencontre d'autres êtres humains, où on peut évoquer ses peurs avec quelqu'un, non, c'est un lieu où l'on est supposé se reposer, se ressourcer avant de repartir au travail. C'est un lieu où l'on est vulnérable.

Il est intéressant, ce changement de perspective, de l'appartement comme lieu de vie et de repos, à l'appartement comme lieu menaçant, terrifiant ; intéressant, mais pas inhabituel dans l'horreur asiatique. C'est dans le fonds le moteur de l'horreur : un lieu banal où quelque chose se casse, quelque chose change, et tout devient imprévisible, inconnu, terrifiant. Qu'est-ce qui casse alors ? Techniquement, rien : le problème ne vient jamais de son propre appartement, toujours de celui du voisin. Dans La dame de la chambre close, fable horrifique de Minetaro Mochizuki, éditée en France en un volume, c'est parce qu'il habite à côté de l'appartement de Yamamoto, jeune homme récemment disparu, que Hiroshi sera harcelé par une femme qui le cherche. Dans La ville sans rue de Jinjo Ito, la folie se répand dans les quartiers de la ville de manière progressive, d'appartement en appartement, comme par un phénomène de contamination. On retrouve la comparaison avec l'épidémie, avec la maladie qui progresse de lieu en lieu, dans Kaïro : lorsque des fantômes apparaissent dans une demeure, les personnages en ferment la porte, et l'encadrent de scotch rouge : au delà de l'intérêt esthétique pour Kurosawa, la pratique renvoie directement au signalement des maisons contaminées, qu'on peut constater lors des épidémies. Une manière de discriminer l'appartement infecté, dont les voisins vont éviter de s'approcher, qu'ils vont éviter d'ouvrir. Le scotch fait à ce titre également office de sceau, de preuve que la contamination ne se répand pas - ou, justement, qu'elle se répand si le ruban rouge est retiré.

Jugulée, l'épidémie ? Pas pour autant, car la contamination a également lieu par le regard. Le voyeurisme est un thème fréquent dans le genre horrifique, et il suffit de voir l'obsession de Jinjo Ito pour la question pour s'en rendre compte (la meilleure illustration en étant La ville sans rue, l'un de ses meilleurs récits). Dans Appartement du coréen Kang Full, c'est en jettant un oeil aux appartements de l'immeuble d'en face que Koh-hyuk surprend d'étranges phénomènes, et c'est en faisant de régulières observations que, par la suite, il décide d'y intervenir. Le regard contamine, observer l'appartement d'en face conduit à participer aux histoires horrifiques qui s'y déroulent. Et Kaïro en est ici le parfait exemple. Internet y est considéré comme un réel outil de voyeurisme, une manière pour les personnages de regarder les appartements des autres, et la contamination a lieu par ce biais : fascination pour les fantômes, terreur, suicide, disparition, nouveaux fantômes. Lieu d'isolement par excellence, ouvert en même temps à toutes les menaces extérieures, l'appartement devient un piège, un espace terrifiant, où le locataire est vulnérable, seul, condamné, face à des manifestations qu'il ne comprend pas, et qui le poussent dans ses derniers retranchements. L'espace horrifique parfait, en somme.
Big-Cow
Pour une autre critique de Kaïro : Ici



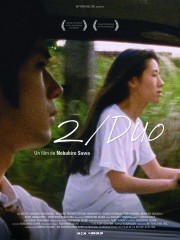




















 leurs habitudes en apparence paisibles et répétitives.Le rapport à la famille, ou au groupe en général, est le prisme de ces révélation, chacun devant se confronter à la masse. Dans Still Walking, récit classique d'un repas de famille où se soulèvent peu à peu les regrets et les questions, le deuxième fils, vivant dans l'ombre du souvenir de son frère décédé à la suite d'un acte de bravoure, ne cesse de se confronter aux exigences de « normalité » que lui renvoient sa sœur ou ses parents. Normalité d'avoir des enfants, même avec la jeune veuve avec laquelle il s'est remarié, normalité d'avoir un travail bien payé (le fils cache ainsi son chômage), normalité d'avoir une voiture pour sa sœur. Au bout d'heure et demie de film, le personnage finit par s'exclamer « Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir être normal ? ». Le fils cadet se confronte ainsi, durant tout le film, à cette exigence d'idéal que lui confèrent ses proches. Lui-même ennuyé par cette exigence, par la frustration de son père qui n'a pas eu de successeur pour son cabinet de médecin, ou par la tristesse de sa mère ayant connu la mort de son frère aîné, le protagoniste ne cesse, par son comportement, d'exacerber ce poids de la normalité. La mise en scène, et plus précisément le travail sur l'espace et le rapport à l'architecture des maisons japonaises, renforce en permanence cette obsession de la « normalité », car les murs qui encadrent les protagonistes caractérisent de fait l'encadrement exigé dans la société.
leurs habitudes en apparence paisibles et répétitives.Le rapport à la famille, ou au groupe en général, est le prisme de ces révélation, chacun devant se confronter à la masse. Dans Still Walking, récit classique d'un repas de famille où se soulèvent peu à peu les regrets et les questions, le deuxième fils, vivant dans l'ombre du souvenir de son frère décédé à la suite d'un acte de bravoure, ne cesse de se confronter aux exigences de « normalité » que lui renvoient sa sœur ou ses parents. Normalité d'avoir des enfants, même avec la jeune veuve avec laquelle il s'est remarié, normalité d'avoir un travail bien payé (le fils cache ainsi son chômage), normalité d'avoir une voiture pour sa sœur. Au bout d'heure et demie de film, le personnage finit par s'exclamer « Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir être normal ? ». Le fils cadet se confronte ainsi, durant tout le film, à cette exigence d'idéal que lui confèrent ses proches. Lui-même ennuyé par cette exigence, par la frustration de son père qui n'a pas eu de successeur pour son cabinet de médecin, ou par la tristesse de sa mère ayant connu la mort de son frère aîné, le protagoniste ne cesse, par son comportement, d'exacerber ce poids de la normalité. La mise en scène, et plus précisément le travail sur l'espace et le rapport à l'architecture des maisons japonaises, renforce en permanence cette obsession de la « normalité », car les murs qui encadrent les protagonistes caractérisent de fait l'encadrement exigé dans la société. dans la société : marginalité car ils n'existent pas, car ils doivent rester cachés, silencieux et enfermés, loin des autres activités que peuvent effectuer les enfants de leur âge. La réalisation de Kore-eda s'avère plus tendue dans ce film, les prises de caméra à l'épaule étant plus fréquentes et l'ensemble traité de manière réaliste, presque documentaire. Par ce choix, Kore-eda fait capter toute une tension autour de ce mystère et de cette peur de se faire découvrir, peur dictée par la consigne de la mère et la séparation induite par les placements en foyer sociaux. De plus, la marginalité apparaît dans ce film par le surprenant contraste entre l'âge des protagonistes et les missions adultes qu'ils s'auto-assignent. Le jeune Akira doit porter toute la responsabilité de l'état de ses frères et sœurs, tente d'agir comme un adulte, tente d'imiter une image d'adulte parfait, tandis que les parents alentours s'avèrent de véritables enfants. Les personnages s'obligent ainsi à se plier à une « normalité » et à des apparences paisibles impossibles à atteindre. Au début du film, la mère d'Akira se présente ainsi comme calme et sérieuse, alors qu'elle se révèle rapidement adolescente dans sa manière de penser.
dans la société : marginalité car ils n'existent pas, car ils doivent rester cachés, silencieux et enfermés, loin des autres activités que peuvent effectuer les enfants de leur âge. La réalisation de Kore-eda s'avère plus tendue dans ce film, les prises de caméra à l'épaule étant plus fréquentes et l'ensemble traité de manière réaliste, presque documentaire. Par ce choix, Kore-eda fait capter toute une tension autour de ce mystère et de cette peur de se faire découvrir, peur dictée par la consigne de la mère et la séparation induite par les placements en foyer sociaux. De plus, la marginalité apparaît dans ce film par le surprenant contraste entre l'âge des protagonistes et les missions adultes qu'ils s'auto-assignent. Le jeune Akira doit porter toute la responsabilité de l'état de ses frères et sœurs, tente d'agir comme un adulte, tente d'imiter une image d'adulte parfait, tandis que les parents alentours s'avèrent de véritables enfants. Les personnages s'obligent ainsi à se plier à une « normalité » et à des apparences paisibles impossibles à atteindre. Au début du film, la mère d'Akira se présente ainsi comme calme et sérieuse, alors qu'elle se révèle rapidement adolescente dans sa manière de penser. L'héroïne d'Air Doll, poupée sexuelle amenée miraculeusement à la vie, tente elle aussi de se plier à la normalité. En découvrant le monde alentour, elle connaît de nombreuses désillusions et tente de s'intégrer à la vie humaine, bien souvent en suivant les publicités et les préjugés. Ses tenues vestimentaires en témoignent, sortes de cosplays hérités des mangas pour jeunes filles, avec petites jupes à volants, tabliers de serveuse, uniformes d'écolières... Elle se fait engager dans une boîte de location de vidéo, les comédies musicales contribuant à surenchérir ses espoirs et sa volonté d'intégration. L'expérience d'Air Doll s'avère aussi une lutte contre la standardisation, cette poupée, par ce phénomène fantastique de vivre, cherchant à échapper à sa fonction primaire, qui est de combler les manques sexuels des hommes. Elle lutte contre le fait d'être un simple produit ou jouet passif et tente de prouver le contraire, fait difficile car de nombreux hommes abusent d'elle par la suite.
L'héroïne d'Air Doll, poupée sexuelle amenée miraculeusement à la vie, tente elle aussi de se plier à la normalité. En découvrant le monde alentour, elle connaît de nombreuses désillusions et tente de s'intégrer à la vie humaine, bien souvent en suivant les publicités et les préjugés. Ses tenues vestimentaires en témoignent, sortes de cosplays hérités des mangas pour jeunes filles, avec petites jupes à volants, tabliers de serveuse, uniformes d'écolières... Elle se fait engager dans une boîte de location de vidéo, les comédies musicales contribuant à surenchérir ses espoirs et sa volonté d'intégration. L'expérience d'Air Doll s'avère aussi une lutte contre la standardisation, cette poupée, par ce phénomène fantastique de vivre, cherchant à échapper à sa fonction primaire, qui est de combler les manques sexuels des hommes. Elle lutte contre le fait d'être un simple produit ou jouet passif et tente de prouver le contraire, fait difficile car de nombreux hommes abusent d'elle par la suite.
 Nobody Knows, le titre de son film le plus plébiscité et, avouons-le, le plus impressionnant, pourrait s'appliquer au cinéma tout entier de Kore-eda. Les personnages souvent enfermés entre quatre murs – les enfants dans l'appartement, la famille réunie dans la maison familiale, la poupée dans la chambre de son propriétaire – symbolisent et rappellent sans cesse le rapport au secret, à l'enfermement des désirs et des envies : la poupée d'Air Doll désirant découvrir le véritable amour par elle-même, en-dehors de la sexualité frustrée qu'elle est censée combler ; la jeune fille voulant aller à l'école dans Nobody Knows, impuissante face à sa mère infantilisante ; et enfin tous les protagonistes de Still Walking, gardant leurs frustrations et leurs colères derrière une façade paisible. Dans ce dernier, le portrait familial s'avère extrêmement fort et d'une justesse remarquable, chacun à la fois incarnant un personnage clé dans la cellule familiale attendue, tout en révélant une certaine cruauté ou un comportement inattendu. Par exemple, la grand-mère aux petits soins pour ses enfants n'hésite pas à torturer psychologiquement le jeune homme ayant été sauvé par son fils décédé, le rappelant à venir se prosterner chaque année.
Nobody Knows, le titre de son film le plus plébiscité et, avouons-le, le plus impressionnant, pourrait s'appliquer au cinéma tout entier de Kore-eda. Les personnages souvent enfermés entre quatre murs – les enfants dans l'appartement, la famille réunie dans la maison familiale, la poupée dans la chambre de son propriétaire – symbolisent et rappellent sans cesse le rapport au secret, à l'enfermement des désirs et des envies : la poupée d'Air Doll désirant découvrir le véritable amour par elle-même, en-dehors de la sexualité frustrée qu'elle est censée combler ; la jeune fille voulant aller à l'école dans Nobody Knows, impuissante face à sa mère infantilisante ; et enfin tous les protagonistes de Still Walking, gardant leurs frustrations et leurs colères derrière une façade paisible. Dans ce dernier, le portrait familial s'avère extrêmement fort et d'une justesse remarquable, chacun à la fois incarnant un personnage clé dans la cellule familiale attendue, tout en révélant une certaine cruauté ou un comportement inattendu. Par exemple, la grand-mère aux petits soins pour ses enfants n'hésite pas à torturer psychologiquement le jeune homme ayant été sauvé par son fils décédé, le rappelant à venir se prosterner chaque année. chez Kore-eda. Le fameux jeu sur l'architecture, les pans de portes ou de murs encadrant les personnages dans de nombreuses séquences, désignent aussi cet étouffement. Chez Nobody Knows, ou chez Air Doll, les séquences en extérieur s'avèrent ainsi bien souvent, et par contraste, le symbole de la libération et de la liberté des corps et des esprits : courses à pied et jeux enfantins pour les jeunes de Nobody Knows ; découverte sensible et sensorielle de la naïve héroïne d'Air Doll. Dans ces séquences, les plus fortes dans ces films, la parole n'agit pas ou s'exerce par de simples exclamations spontanées, et le corps prend le dessus, connaît la libération pour un temps, ne se soucie pas des apparences. Dans Still
chez Kore-eda. Le fameux jeu sur l'architecture, les pans de portes ou de murs encadrant les personnages dans de nombreuses séquences, désignent aussi cet étouffement. Chez Nobody Knows, ou chez Air Doll, les séquences en extérieur s'avèrent ainsi bien souvent, et par contraste, le symbole de la libération et de la liberté des corps et des esprits : courses à pied et jeux enfantins pour les jeunes de Nobody Knows ; découverte sensible et sensorielle de la naïve héroïne d'Air Doll. Dans ces séquences, les plus fortes dans ces films, la parole n'agit pas ou s'exerce par de simples exclamations spontanées, et le corps prend le dessus, connaît la libération pour un temps, ne se soucie pas des apparences. Dans Still  Walking, les moments d'extérieur font souvent place à la sérénité et au repos, notamment lorsque les protagonistes retournent sur les lieux du drame de l'accident et de la mort du fils aîné, car ils sortent du cocon familial et de la fameuse maison pleine de souvenirs et d'exigences quotidiennes. Cependant, sans cette accroche à l'habitat, les personnages ne pourraient survivre. Paradoxalement, l'appartement de Nobody Knows recèle de dangers, mais s'avère plus d'une fois un refuge. Et la poupée d'Air Doll finit sa vie à l'état de déchet, abandonnée dans la rue, se sentant totalement rejetée de tout habitat ou lieu d'intégration.
Walking, les moments d'extérieur font souvent place à la sérénité et au repos, notamment lorsque les protagonistes retournent sur les lieux du drame de l'accident et de la mort du fils aîné, car ils sortent du cocon familial et de la fameuse maison pleine de souvenirs et d'exigences quotidiennes. Cependant, sans cette accroche à l'habitat, les personnages ne pourraient survivre. Paradoxalement, l'appartement de Nobody Knows recèle de dangers, mais s'avère plus d'une fois un refuge. Et la poupée d'Air Doll finit sa vie à l'état de déchet, abandonnée dans la rue, se sentant totalement rejetée de tout habitat ou lieu d'intégration.
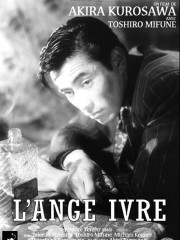










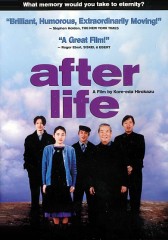
 naïveté dans cette société si particulière, chargée d'aider les morts à sélectionner un souvenir de leur vie, avant de n'emporter que ce fragment avec eux, fragment reconstitué, à la fin d'une semaine de remémoration et d'entretien, dans la réalisation d'un film. Dans cette sorte de recherche de l'apaisement et du « repose en paix », certains pourraient voir un mélodrame chargé d’effets spéciaux et de décors féeriques. Rien de tout cela dans After Life. La société est constituée d'une poignée de personnes simples, trois hommes chargés des entretiens, un directeur et une jeune fille à l’assistanat et un concierge, le lieu de résidence est un vieux pensionnat décrépi et paisible. Chaque pensionnaire arrive depuis la brume, déclinant son identité à l'accueil. L'aspect huis-clos entraîne l'ensemble dans l'étrange, d'autant plus que le lieu répond à quelques
naïveté dans cette société si particulière, chargée d'aider les morts à sélectionner un souvenir de leur vie, avant de n'emporter que ce fragment avec eux, fragment reconstitué, à la fin d'une semaine de remémoration et d'entretien, dans la réalisation d'un film. Dans cette sorte de recherche de l'apaisement et du « repose en paix », certains pourraient voir un mélodrame chargé d’effets spéciaux et de décors féeriques. Rien de tout cela dans After Life. La société est constituée d'une poignée de personnes simples, trois hommes chargés des entretiens, un directeur et une jeune fille à l’assistanat et un concierge, le lieu de résidence est un vieux pensionnat décrépi et paisible. Chaque pensionnaire arrive depuis la brume, déclinant son identité à l'accueil. L'aspect huis-clos entraîne l'ensemble dans l'étrange, d'autant plus que le lieu répond à quelques « bizarreries » : abandonné et délaissé, les fougères et la nature s'infiltrent autour des murs, l’électricité fonctionne mal, une voix métallique résonne dans les chambres et scande les différents délais de la semaine, la lune observée par l'un des employés s'avère être un volet peint. Les entretiens s’apparentent quant à eux à des sujets de psychanalyse, où les personnages se retrouvent en face du miroir de leur vie. Une caméra frontale, vierge de tout jugement, laisse le temps à ces personnages de s'exprimer. Il est fort possible que l'improvisation eut son rôle dans ces séquences simples mais bouleversantes, tant chaque protagonistes s'exprime avec justesse, rappelant des faits à la fois très personnels qui qui revêtissent un caractère universel pour la plupart. On songe aux scènes de remémoration dans
« bizarreries » : abandonné et délaissé, les fougères et la nature s'infiltrent autour des murs, l’électricité fonctionne mal, une voix métallique résonne dans les chambres et scande les différents délais de la semaine, la lune observée par l'un des employés s'avère être un volet peint. Les entretiens s’apparentent quant à eux à des sujets de psychanalyse, où les personnages se retrouvent en face du miroir de leur vie. Une caméra frontale, vierge de tout jugement, laisse le temps à ces personnages de s'exprimer. Il est fort possible que l'improvisation eut son rôle dans ces séquences simples mais bouleversantes, tant chaque protagonistes s'exprime avec justesse, rappelant des faits à la fois très personnels qui qui revêtissent un caractère universel pour la plupart. On songe aux scènes de remémoration dans  doivent choisir, revenir sur leur vie, se remémorer des bons et des auvais moments. Un fort rapport se joue entre les générations et ainsi s'affirme un thème fort dans la culture japonaise, à savoir le lien générationnel, l'importance du passé et du respect des trépassés. Pour certains, ce sont les souvenirs de guerre, fascinants et racontés avec la précision d'un historien qui resurgissent ; pour d'autre, plus jeunes, les souvenirs de sortie entre amis, comme à Disneyland. Le souci de la mémoire collective se mêle à l'évocation intime. D'autres refusent de jouer le jeu par provocation, peut-être effrayé à l'idée d'approcher son passé et son parcours ; d'autres retombent en enfance comme cette touchante petite vieille dame qui ramasse des feuilles et des fleurs dans le parc. Des femmes se remémorent la fierté d'avoir été aimée par un homme, des hommes étalent leur vie sexuelle active avec vulgarité et orgueil. Le mensonge affleure, la recherche s'affine, les esprits échappent au temps présent. Parmi tous ces personnages, un se distingue par son effrayante normalité. Protagoniste dans la norme, à la vie paisible mais sans grande personnalité, qui ne parvient pas à faire émerger de cet ensemble monotone une note plus élevée, un souvenir plus léger, un souvenir spécifique. Par ce personnage, on approche les fameux employés et on saisit leur histoire.
doivent choisir, revenir sur leur vie, se remémorer des bons et des auvais moments. Un fort rapport se joue entre les générations et ainsi s'affirme un thème fort dans la culture japonaise, à savoir le lien générationnel, l'importance du passé et du respect des trépassés. Pour certains, ce sont les souvenirs de guerre, fascinants et racontés avec la précision d'un historien qui resurgissent ; pour d'autre, plus jeunes, les souvenirs de sortie entre amis, comme à Disneyland. Le souci de la mémoire collective se mêle à l'évocation intime. D'autres refusent de jouer le jeu par provocation, peut-être effrayé à l'idée d'approcher son passé et son parcours ; d'autres retombent en enfance comme cette touchante petite vieille dame qui ramasse des feuilles et des fleurs dans le parc. Des femmes se remémorent la fierté d'avoir été aimée par un homme, des hommes étalent leur vie sexuelle active avec vulgarité et orgueil. Le mensonge affleure, la recherche s'affine, les esprits échappent au temps présent. Parmi tous ces personnages, un se distingue par son effrayante normalité. Protagoniste dans la norme, à la vie paisible mais sans grande personnalité, qui ne parvient pas à faire émerger de cet ensemble monotone une note plus élevée, un souvenir plus léger, un souvenir spécifique. Par ce personnage, on approche les fameux employés et on saisit leur histoire.  personnages de retrouver leur passé, de fixer leur mémoire et d'assurer leur départ vers l'au-delà. Les employés, grâce aux témoignages, tournent un film s'attachant à reconstituer les sensations des morts. Très belle idée, où la fixation de la pellicule permet de métaphoriser la fixation du souvenir, qui ne restera cependant jamais totalement restitué. Le contraste se joue entre les images évoquées par les mots poétiques des personnages et le plateau décor, plus concret, tentant de remplacer les choses par des effets spéciaux ou des décors kitschs. Le banc de nuages traversé par un aviateur se concrétise par le rang de masses de coton suspendues sur des fils de linge. Les éclairages roses et jaunes tendent à restituer une ambiance romantique. Et pourtant, la plupart des personnages prennent du plaisir à observer le tournage, s'amusent à rencontrer leur double acteur ou à mettre en place la scène. Comme si chacun tentait de remettre en scène sa vie pour la transformer en une scène parfaite, idéalisée par le cinéma.
personnages de retrouver leur passé, de fixer leur mémoire et d'assurer leur départ vers l'au-delà. Les employés, grâce aux témoignages, tournent un film s'attachant à reconstituer les sensations des morts. Très belle idée, où la fixation de la pellicule permet de métaphoriser la fixation du souvenir, qui ne restera cependant jamais totalement restitué. Le contraste se joue entre les images évoquées par les mots poétiques des personnages et le plateau décor, plus concret, tentant de remplacer les choses par des effets spéciaux ou des décors kitschs. Le banc de nuages traversé par un aviateur se concrétise par le rang de masses de coton suspendues sur des fils de linge. Les éclairages roses et jaunes tendent à restituer une ambiance romantique. Et pourtant, la plupart des personnages prennent du plaisir à observer le tournage, s'amusent à rencontrer leur double acteur ou à mettre en place la scène. Comme si chacun tentait de remettre en scène sa vie pour la transformer en une scène parfaite, idéalisée par le cinéma. 



