YAU DOH LUNG FU BONG - JUDO - THROW DOWN (2004) – Johnnie To

Dédié à Akira Kurosawa, ce film de Johnnie To, quelque peu oublié et occulté par d'autres grands succès plus explosifs, ne manque pourtant ni d'originalité, ni de charisme. A travers cette intrigue uniquement centrée sur l'art et la pratique du judo, Johnnie To fait partager les aventures d'un trio de personnages attachant, s'ancrant plus dans sa veine comique et lyrique, comme il l'a démontré avec des films tel que Sparrow.

Judo s'avère en effet porté par un véritable dynamisme. Contrairement à son dernier film en salles, la Vie sans Principe, plus audacieux et réfléchi mais pêchant par un scénario tortueux, Judo choisit une véritable clarté, les séquences se suivant dans une logique agréable, l'intrigue  étant ponctuée par de belles pauses lyriques, comme une folle course-poursuite avec des billets de banque dans les bras ou une longue tentative pour décrocher un ballon de baudruche abandonné dans des branchages. Ces très belles séquences, bien souvent portées par l'unique personnage féminin détonnant du film, donnent un véritable sentiment de liberté. Car l'intrigue s'axe en effet sur la recherche de la liberté pour les différents personnages. La femme, Mona, sorte de vagabonde de luxe se rêvant chanteuse à Hong Kong, puis au Japon, l'incarne
étant ponctuée par de belles pauses lyriques, comme une folle course-poursuite avec des billets de banque dans les bras ou une longue tentative pour décrocher un ballon de baudruche abandonné dans des branchages. Ces très belles séquences, bien souvent portées par l'unique personnage féminin détonnant du film, donnent un véritable sentiment de liberté. Car l'intrigue s'axe en effet sur la recherche de la liberté pour les différents personnages. La femme, Mona, sorte de vagabonde de luxe se rêvant chanteuse à Hong Kong, puis au Japon, l'incarne amplement, totalement libérée et sans attaches, assoiffée d'aventures. D'autre part, le second protagoniste, Tony, est un jeune homme intrépide et surdoué en judo, s'étant mis en tête de combattre les plus grands noms, lui aussi porté par une forme d'indépendance et de liberté. Tous deux, ils se heurtent à l'indifférence de Sze-to, ancien champion de judo ayant sombré dans l'alcool. Sze-to, un personnage dramatique par sa condition, devient cependant très drôle sous la mise en scène de Johnnie To, ou l'interprétation de son acteur, l'excellent Louis Koo (la redoutable tête montante d'Election 1 et 2), l'ancien champion de judo devenant un être indifférent au monde qui l'entoure et d'une mollesse terrifiante jusqu'à en être comique. Ainsi, l'une des séquences du film présente l'union de ces trois protagonistes à travers une excellente séquence de vol à la tire dans une salle de jeux d'arcade. La futilité de cet acte infantile rappelle les pickpockets casse-cou de Sparrow, organisés comme une mini-mafia à l'échelle d'un jeu d'enfants.
amplement, totalement libérée et sans attaches, assoiffée d'aventures. D'autre part, le second protagoniste, Tony, est un jeune homme intrépide et surdoué en judo, s'étant mis en tête de combattre les plus grands noms, lui aussi porté par une forme d'indépendance et de liberté. Tous deux, ils se heurtent à l'indifférence de Sze-to, ancien champion de judo ayant sombré dans l'alcool. Sze-to, un personnage dramatique par sa condition, devient cependant très drôle sous la mise en scène de Johnnie To, ou l'interprétation de son acteur, l'excellent Louis Koo (la redoutable tête montante d'Election 1 et 2), l'ancien champion de judo devenant un être indifférent au monde qui l'entoure et d'une mollesse terrifiante jusqu'à en être comique. Ainsi, l'une des séquences du film présente l'union de ces trois protagonistes à travers une excellente séquence de vol à la tire dans une salle de jeux d'arcade. La futilité de cet acte infantile rappelle les pickpockets casse-cou de Sparrow, organisés comme une mini-mafia à l'échelle d'un jeu d'enfants.

Le film tire, comme Exilé, beaucoup d'inspirations du western. Afin de rendre la tension sur les séquences de combat de judo, qui sont loin d'avoir comme avantage la violence des balles, la réalisation use de nombreux procédés pour capter l'attention d'un spectateur lambda, et créer une atmosphère captivante. Les corps volent dans la poussière, les prises s'enchaînent comme des fusillades à répétition, chaque chute au sol semblant s'assimiler à une balle tirée, ce n’est plus le calibre qui en impose, mais bien plus la silhouette, la précision du geste. Les échanges de répliques sonnent toujours avec menace et charisme, comme toujours avec Johnnie To, notamment parce que la cinématographie de Judo privilégie l'obscurité des bars et l'asphalte des rues nocturnes. En effet, rares sont les séquences de tatamis, ceux-ci étant reclus à un imaginaire nostalgique : Sze-To vient s'allonger dans la salle d'entraînement de son ancien maître décédé, effleurant les tatamis, se souvenant du contact avec ce sol adapté au sport de combat. Autrement, dans une première partie, les séquences de combat s'agencent comme typiques du western ou du film noir, les corps baignés dans une semi-clarté, l'éclairage étant toujours extrêmement symbolique, assimilant la déchéance de Sze-To et sa propension à l'alcool à un rapport au gouffre et à la chute, au sens propre du terme, contre un sol noir et lourd. Dans la seconde partie, pas forcément la plus intéressante du film, celle où Sze-to se « réveille » en quelque sorte, l'espace devient cependant plus éclairé, les scènes de combat plus extatiques et moins portées à la stylisation impressionnante de la première heure.

Enfin, le film étant dédié à Akira Kurosawa, on retrouve curieusement une forme d'ostentation proche du cinéma japonais. Certaines séquences s'avèrent presque suspendues, poétiques, ou lyriques, comme la course-poursuite entre Mona, Sze-to et leurs assaillants, après le vol d'une liasse de billets dans un tripot. Les billets s'envolent, et la musique porte cette très belle séquence, différente des séquences habituelles de course-poursuite. Un même effet d’ostentation se trouve exactement au milieu du film, durant la plus importante scène d'affrontement dans la rue, où sont utilisés de nombreux ralentis surplombant les corps ou s'infiltrant entre eux, rappelant le final d'Exilé ou la scène sur le terrain vague de Vengeance. De plus, trois chants symboliques sont entonnés a capella dans le film, sortes de chants légendaires interprétés par un protagoniste témoin de toutes les scènes, en tant qu'acte de début, milieu, et fin du récit. La présence de ces chants assimile Judo à un mélodrame, tout comme Kurosawa a souvent exploré la violence des sentiments avec fougue et passion dans ses réalisations. Cependant, le film de Johnnie To est loin de prétendre à l'émotion du cinéma du grand maître japonais, son film restant délibérément dans un ton léger. Le film pose tout de même les questions d'honneur et de condition humaine, celle-ci caractérisée par les expériences accumulées d'un homme dans sa vie. De fait, le récit de Sze-to s'avère marqué par le sens du retour aux sources, vu que le protagoniste s'installe dans l'ancien dôjô de son maître, s'occupe de son fils handicapé, donc reprend et fait revivre un certain passé, mais aussi par le sens de la renaissance et donc de l'achèvement d'une quête.

Judo n'est pas un Johnnie To mineur. Certes plus amusant et plus libéré que la violence d'Election, d'Exilé ou même de la Vie sans Principe, il se distingue du divertissant Running out of Time par son originalité et sa réalisation soignée, symbolique, plus proche et aussi attachant que le ludique Sparrow.













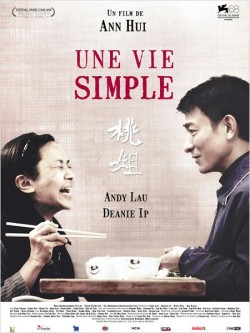




 Le film dresse tout d'abord un portrait très élogieux du maître, vu tout du long comme un personnage généreux et noble (aucune allusion à son addiction à l'opium, par exemple). Dans Ip man, il est plus question de poser un dilemme que de connaître le gagnant ou le perdant dans les combats. En effet, la supériorité et la sagesse de Yip dans les arts martiaux est d'emblée acceptée et vénérée, et la plupart des combats visent à réaffirmer ses capacités et sa puissance. Au-delà des affrontements, le film est surtout l'occasion de poser ce fameux dilemme entre l'intensité d'une vie de combat et la paisibilité d'une vie de famille pacifique avec sa femme et son fils. Au final, c'est l'arrivée de la guerre et de l'occupation des Japonais qui va décider du sort de Yip, contraint à jouer les prodigues devant un commandant japonais féru de wing chun. Intrigue pour le moins
Le film dresse tout d'abord un portrait très élogieux du maître, vu tout du long comme un personnage généreux et noble (aucune allusion à son addiction à l'opium, par exemple). Dans Ip man, il est plus question de poser un dilemme que de connaître le gagnant ou le perdant dans les combats. En effet, la supériorité et la sagesse de Yip dans les arts martiaux est d'emblée acceptée et vénérée, et la plupart des combats visent à réaffirmer ses capacités et sa puissance. Au-delà des affrontements, le film est surtout l'occasion de poser ce fameux dilemme entre l'intensité d'une vie de combat et la paisibilité d'une vie de famille pacifique avec sa femme et son fils. Au final, c'est l'arrivée de la guerre et de l'occupation des Japonais qui va décider du sort de Yip, contraint à jouer les prodigues devant un commandant japonais féru de wing chun. Intrigue pour le moins classique, mais pas désagréable, donnant son pourcentage d'action habituel. La réflexion politique reste mince, avec une série de personnages plus ou moins caricaturés : du commandant assez digne et paradoxalement fasciné par Yip à son adjoint insupportable par ses grimaces et sa cruauté excessive et gratuite, en passant par le mercenaire infantile, ou le garant de la loi, chargé de la traduction et divisé entre les deux clans.
classique, mais pas désagréable, donnant son pourcentage d'action habituel. La réflexion politique reste mince, avec une série de personnages plus ou moins caricaturés : du commandant assez digne et paradoxalement fasciné par Yip à son adjoint insupportable par ses grimaces et sa cruauté excessive et gratuite, en passant par le mercenaire infantile, ou le garant de la loi, chargé de la traduction et divisé entre les deux clans.









 étant ponctuée par de belles pauses lyriques, comme une folle course-poursuite avec des billets de banque dans les bras ou une longue tentative pour décrocher un ballon de baudruche abandonné dans des branchages. Ces très belles séquences, bien souvent portées par l'unique personnage féminin détonnant du film, donnent un véritable sentiment de liberté. Car l'intrigue s'axe en effet sur la recherche de la liberté pour les différents personnages. La femme, Mona, sorte de vagabonde de luxe se rêvant chanteuse à Hong Kong, puis au Japon, l'incarne
étant ponctuée par de belles pauses lyriques, comme une folle course-poursuite avec des billets de banque dans les bras ou une longue tentative pour décrocher un ballon de baudruche abandonné dans des branchages. Ces très belles séquences, bien souvent portées par l'unique personnage féminin détonnant du film, donnent un véritable sentiment de liberté. Car l'intrigue s'axe en effet sur la recherche de la liberté pour les différents personnages. La femme, Mona, sorte de vagabonde de luxe se rêvant chanteuse à Hong Kong, puis au Japon, l'incarne amplement, totalement libérée et sans attaches, assoiffée d'aventures. D'autre part, le second protagoniste, Tony, est un jeune homme intrépide et surdoué en judo, s'étant mis en tête de combattre les plus grands noms, lui aussi porté par une forme d'indépendance et de liberté. Tous deux, ils se heurtent à l'indifférence de Sze-to, ancien champion de judo ayant sombré dans l'alcool. Sze-to, un personnage dramatique par sa condition, devient cependant très drôle sous la mise en scène de Johnnie To, ou l'interprétation de son acteur, l'excellent Louis Koo (la redoutable tête montante d'Election 1 et 2), l'ancien champion de judo devenant un être indifférent au monde qui l'entoure et d'une mollesse terrifiante jusqu'à en être comique. Ainsi, l'une des séquences du film présente l'union de ces trois protagonistes à travers une excellente séquence de vol à la tire dans une salle de jeux d'arcade. La futilité de cet acte infantile rappelle les pickpockets casse-cou de Sparrow, organisés comme une mini-mafia à l'échelle d'un jeu d'enfants.
amplement, totalement libérée et sans attaches, assoiffée d'aventures. D'autre part, le second protagoniste, Tony, est un jeune homme intrépide et surdoué en judo, s'étant mis en tête de combattre les plus grands noms, lui aussi porté par une forme d'indépendance et de liberté. Tous deux, ils se heurtent à l'indifférence de Sze-to, ancien champion de judo ayant sombré dans l'alcool. Sze-to, un personnage dramatique par sa condition, devient cependant très drôle sous la mise en scène de Johnnie To, ou l'interprétation de son acteur, l'excellent Louis Koo (la redoutable tête montante d'Election 1 et 2), l'ancien champion de judo devenant un être indifférent au monde qui l'entoure et d'une mollesse terrifiante jusqu'à en être comique. Ainsi, l'une des séquences du film présente l'union de ces trois protagonistes à travers une excellente séquence de vol à la tire dans une salle de jeux d'arcade. La futilité de cet acte infantile rappelle les pickpockets casse-cou de Sparrow, organisés comme une mini-mafia à l'échelle d'un jeu d'enfants. 

















