Suis-moi je te fuis / Fuis-moi je te suis
12ème Festival du Film Coréen à Paris
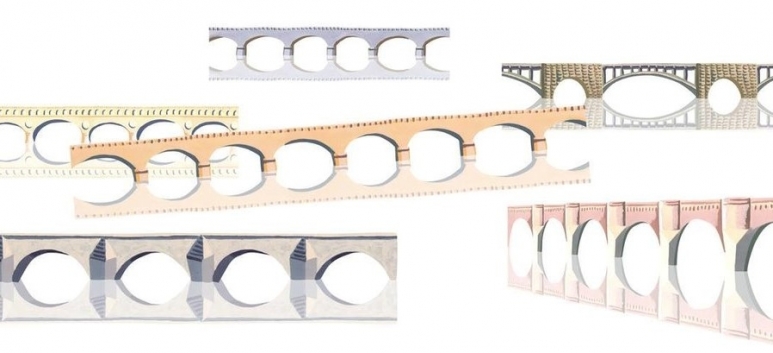
12ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM CORÉEN À PARIS
du 24 au 31 octobre 2017
En novembre dernier se tenait la 12ème édition du populaire festival dédié au Pays du Matin Calme. A contrario, et dans la continuité de son foudroyant succès de 2016, l'événement fut agité par les foules nombreuses, les invités prestigieux, la projection des derniers gros succès comme de sa production art et essai.
Parmi des films très divers, un fil rouge se maintenait : celui du récent tremblement de terre politique ayant agité l'année 2016. Beaucoup de films intégraient, concrètement ou malicieusement, des références au régime en place. L'année précédente avait déjà étalé la violence de la corruption – avec Inside Men ou Asura – celle-ci affichait le désir de révolution et d'engagement. La rétrospective autour du thème des tumultueuses années 1980 dressait évidemment un rappel et un écho édifiants à la récente destitution de la Présidente Park. Manifestations dans les rues contre un état oppresseur, état des lieux alarmant sur le milieu militaire ou policier, jeunesse en colère ou instable, et bien souvent en fuite contre son temps, telles étaient les thématiques de ce 12ème festival.
Cet engouement politique présent à tous les étages de la production – du petit documentaire à la grosse production – faisait plaisir à constater et donnait de l'inspiration quant à notre actuelle situation gouvernementale ombrageuse.
Dans la tradition des précédents compte-rendus de festival, petit parcours hiérarchique parmi les 15 films découverts dans les salles confortables du Publicis.
THE POET AND THE BOY (시인의 사랑 ) – Yang-hee KIM
Section Paysage

A chaque festival son film rejeté. À la différence de certaines de mes connaissances séduite par ce drame en demi-teinte, j'eus du mal à m'attacher au héros de The Poet and the Boy comme à son parcours. Par extension, la plupart des films tenant à suivre des personnages imposés comme « médiocres » dès le départ, auxquels ont attribue tous les défauts avec une once de pathétisme, pour ensuite le réhabiliter vers la lumière, ont tendance à m'irriter. The Poet and The Boy fonctionne sur ce schéma : au centre de son intrigue un trentenaire désabusé par son entourage et sa vie, et qui ne trouve qu'un réconfort passager dans ses vers. Sa rencontre avec un jeune éphèbe vendeur de donuts va questionner sa volonté et ses désirs.

Oui nous sommes presque dans un Mort à Venise version contemporaine et sud-coréenne. Pour autant, l'exercice d'équilibre – entre l'affleurement du coming-out, la recherche poétique, le portrait sociétal – tourne rapidement au grotesque tant le cinéaste ne parvient pas à harmoniser les différents tons – de lyrique à comique, d'onirique à trivial. Plus précisément, Yang-hee Kim maîtrise mal ces différents registres et se réfugie derrière des stéréotypes du genre. Ah, la ballade en forêt imaginaire pour simuler la concentration du poète en action ; le ralenti sur les détails d'un jeune corps pour incarner le désir ; les remarques intimes dites en plein public par la compagne de notre héros pour créer le comique de situation... The Poet and The Boy ennuie vite et ne parvient pas à donner à son sujet la densité nécessaire pour se permettre de naviguer entre les styles. Le film reçut en outre la collaboration de nombreux poètes renommés de Corée pour son écriture. Un comble qui enjoint plutôt à voir ou revoir le cinquième long-métrage de Lee Chang-dong.
STATE AUTHORIZED TEXTBOOK (국정교과서 516일) – Seung-woo BAEK
Section Paysage
State-Authorized Textbook souffre du même déséquilibre que bon nombre de documentaires. Le sujet sur lequel Seung-woo Baek choisit de se focaliser est passionnant, les possibilités de le traiter multiples, et pourtant il fait le choix d'imposer un point de vue rigoureusement démonstratif.

Or, le montage, extrêmement découpé, en vient à aligner des morceaux de paroles par-ci par-là, et brode un dense condensé syntaxique entre les différents intervenants, dont certains ne restent que quelques secondes à l'écran. Ce rythme syncopé pose problème au vu du sujet fort sérieux. En 2015, le gouvernement décide d'introduire au programme scolaire un manuel d'histoire rédigé par le parti d'extrême droite, sans consultation auprès des enseignants ou de la commission chargé de valider les ouvrages. Or, les nombreux historiens interrogés, d'origines politiques diverses, dénoncent les inexactitudes et les fausses affirmations nombreuses dans le manuel. En filigrane de cet acte révélateur de la politique de l'époque, le film, ou plus exactement les propos posent des questions sur l'implication d'un Etat dans l'enseignement public. Cependant, au lieu de laisser la place à cette réflexion souvent complexe, le réalisateur impose un montage qui déstructure chaque phrase, projette d'un graphe à l'autre, ou s'alourdit d'inscriptions visuelles à l'écran. Dans ce montage, aucune respiration n'est accordée pour la bonne réflexion des spectateurs – ou même le développement complet des historiens interrogés. Sous le fait d'une cruelle ironie, State-Authorized Textbook tombe presque dans les travers qu'il souhaite dénoncer : un embrouillamini visuel et discursif qui crée la confusion et ne permet pas de mieux comprendre les enjeux politico-historiques.

En revanche, le film accorde quelques minutes à la méthode d'un professeur d'histoire en lycée. Celui-ci enjoint ses élèves à mener de nombreux débats à partir des connaissances et de leurs recherches personnelles. L'exemple, passionnant, est malheureusement peu mis en avant.
MIDNIGHT RUNNERS (청년경찰) – Joo-Hwan KIM
Section Événements

Certes, la comédie de fin de festival redonnait le sourire après une sélection aux films majoritairement dramatiques et tendus. Pour autant, le film de Joo-Hwan Kim ne se distingue pas par un humour révolutionnaire, ni même très fin. Deux jeunes hommes rentrent à l’école de police et découvrent la difficile discipline dispensée. Durant leur première permission, ils se retrouvent par hasard impliqués dans une sombre histoire de trafic… Le film joue allégrement sur les effets du buddy movie, transposé dans un contexte plus juvénile - les deux jeunes s’engagent dans la vie d’adulte, ont leurs premières confrontations avec des filles, font face aux difficultés de leur métier, s’interrogent sur la justesse… En toile de fond, le portrait d’une école de police rigide, et se révélant impuissante face à la réalité, est plutôt intéressant puisqu’il filtre au travers des lourds ressorts comiques, comme le jeu exagérément sévère des supérieurs, la rivalité tantôt taquine tantôt impitoyable entre les différents garçons, le côté très “internat” de l’établissement qui rend les héros facilement impressionnables dès qu’ils sortent en permission…

Mais une fois passée la première petite heure, Midnight Runners s’enlise dans une intrigue policière peu convaincante, extrêmement manichéenne - le Chinois brutal et sans pitié, les jeunes filles éplorées qu’il s’agit de sauver - dont l’intérêt est plutôt soutenu par d’excellentes scènes d’action très maîtrisées. En outre, le duo formé par Seo-joon Park et Ha-neul Kang agace vite par leurs comportements grotesques. Les deux jeunes stars du film jouent totalement la carte de l'adolescence et surenchérissent dans les réactions naïves et abrutissantes. Sans oublier le sexisme malvenu qui réduit vite les protagonistes féminins à quelques objets de fantasme qu’il faut secourir…
NEW TRIAL (재심) – Tae-Yoon KIM
Section Paysage

« On se demande quand est-ce qu'ils vont se rouler des pelles ». Effectivement, passé la première longue heure du film, le long face-à-face, yeux dans les yeux, des deux personnages principaux inaugure le moment de la revanche et de la bataille conclusive dans New Trial. Cette réaction d'une collègue blogueuse qui se reconnaîtra résumait parfaitement l’atmosphère et le goût de la bromance de plus en plus développés dans les films d'action sud-coréens. Sans-pitié l'avait déjà prouvé cette année en salles françaises, de même qu'Inside Men en 2016. New Trial se rapproche en outre de ce dernier par la commune peinture d'un milieu judiciaire peinant à révéler les corruptions politiques ou policières. Le film de Tae-Yoon Kim agit cependant moins finement et moins brillamment que son prédécesseur.

Déjà, le personnage incarné par la jeune star Ha-neul Kang - l’un des deux étudiants du film chroniqué ci-dessus - n'est guère opaque, et se résume à son rôle de victime tourmenté par sa persécution et réduit au silence traumatique. Face à lui, un avocat quelconque, un peu véreux mais joueur (Woo Jung), se redécouvre un sens de la justice qu’il avait perdu. Le scénario tente de contourner un peu la facilité du film de procès rendant justice et glisse quelques développements intéressants. Mais la nécessaire salvation du condamné s’impose rapidement. De même, la proche relation entre l’avocat et son client ne surprend guère. En face, les véritables antagonistes tirant les ficelles du système pour quelques privilèges personnels, se devinent également aisément. Dans Inside Men, le récit avait l’audace de bousculer en finesse de nombreux codes du genre - par exemple en proposant une victime tout autant bourreau que les autres - et de verser dans un certain romanesque réjouissant. Ici, New Trial est sans coups d’éclat et se déguste comme un bon divertissement.
JAMSIL (누에치던 방) – Wan-min LEE
Section Paysage

Ce premier long-métrage impose, plus que le contraste des temps, leur dilution et leur entremêlement complexe. Complexe car la densité de scènes et de personnages impliqués - dont certains grandissent ou ne changent pas, dont certains aiment à changer d’identité - créa une certaine perplexité chez les spectateurs français. En témoignèrent les réactions après la projection, entre Français perdus et Coréens parfaitement à l’aise avec l’étrange construction du scénario. Au grand dam de ma voisine (Coréenne), j’eus personnellement beaucoup de mal avec cette première oeuvre, la trouvant inutilement confuse et très inégale dans la gestion de ses différentes réflexions.

Deux femmes ne se connaissant pas tentent de se remettre de la disparition de leurs meilleures amies respectives, avec qui elles projetaient le monde au lycée. Le hasard les fait se rencontrer. Les frontières se floutent rapidement entre les jeunes filles du passé et les femmes mûres du présent, mais également entre les deux duos. L’accumulation de scènes comme un scénario tortueux peinent à établir une véritable adhésion aux protagonistes et à leurs névroses. Parce qu’elle souhaite plus créer des passerelles entre les différents aspects du film, la réalisatrice contourne trop longuement la vérité de ses personnages, et de fait rend difficile l’identification comme l’attachement à eux. Sa recherche de l’hermétique n’excuse pas la chaotique construction et la platitude de certains plans. Cela est fort dommage. Car la profondeur du sujet - trouver une certaine reconstruction en tentant de revivre les amitiés du passé, pourtant impossibles du fait des contraintes sociales et de l’évolution des êtres - met courageusement en parallèle les aspects noirs de la société sud-coréenne actuelle : le chômage, le refus de rentrer dans le moule, la fine frontière entre la solitude et l’indépendance...
A TAXI DRIVER (택시 운전사 ) – Hun JANG
Section Focus
A Taxi Driver est un excellent film d'action réunissant également biopic, comédie et mélodrame. Sur ce dernier registre, le film d'Hun Jang présente des écueils, notamment avec sa fin tire-larmes et inutilement rallongée. Au-delà, le mélange des genres plaît et rend accessible la grande histoire du pays à travers la petite.

En 1980, le mouvement pour la démocratisation de Gwangju est violemment réprimé par les militaires sur place, par décision de la dictature en place. Mais à l’extérieur du pays, la vision délivrée par des médias contrôlés dresse une autre réalité, où le soulèvement est remplacé par une guerre civile, et les citoyens martyrs par de violents contestataires. Par hasard, un taximan embarque, face à l’affriolante somme d’argent proposée, un reporter allemand. Il ne se doute pas qu’une fois accédé à la ville, il découvrira un tout autre paysage. Le protagoniste principal, sujet de ce film alors que sa véritable identité ne fut jamais connue dans la réelle histoire, est à la fois témoin et militant face aux événements. Le choix de Song Kang-ho tombe sous le sens, puisque seul un acteur avec une palette de jeu suffisamment étendue pouvait embrasser cette figure intermédiaire et créer l’adhésion immédiate. Pour la réalisation, le film est soutenu avec efficacité et restitue avec une impressionnante violence les batailles dans la rue.

A Taxi Driver tire habilement parti du récit historique pour le convertir en film d’action. Comme enjeu, le pouvoir de l’image témoin qu’il faut à tout prix conserver. Comme de tous les coins, les militaires, souvent en civils, menacent de s’emparer des précieuses bobines, le film valorise, dans un second temps, la cours-poursuite avec ses temps de latence et d’accélération. La réconfortante soirée passée avec quelques civils durant le couvre-feu comme le last time rescue des taximen de la ville à la fin sont mémorables dans cette construction. Dommage que le réalisateur se soit engagé dans un dernier segment complaisant pour clôturer son film.
THE 6 DAYS STRUGGLE AT MYONG-DONG CATHEDRAL (명성, 그 6일의 기록, 1997) – Dong-won KIM
Section Focus

Second film que j’ai pu découvrir dans la section focus, The 6 Days Struggle… est un document important dans l’histoire du cinéma militant coréen. Il concentre les images filmées sur le vif d’un événement important dans la protestation contre le gouvernement Suite à une manifestation mouvementée, des étudiants et des travailleurs sociaux se retrouvent acculés dans la cathédrale Myong-Dong. ils décident d’y rester et de bâtir un véritable siège, et reçoivent progressivement le soutien de toute la population. Malgré son échec, la lutte à la cathédrale marque le début du mouvement de démocratisation de 1987 dans le pays.

Très dense et parfois un peu maladroit dans son montage - cependant excusé par les faibles moyens du bord et la difficulté de pouvoir tout enregistrer dans des conditions de manifestations houleuses et violentes - le film passionne par la diversité de points de vue qu’il propose. Le réalisateur a réussi à trouver, dix ans plus tard, les têtes de file de cette occupation. Beaucoup d’étudiants sont devenus salariés et parlent plus ou moins sérieusement de l’événement : certains sont sidérés par leur assurance de l’époque, d’autres en sont fiers. La distance des regards par rapport à un acte devenu symbolique est fort intéressante à observer, et questionne beaucoup quant à la signification de l’engagement et du militantisme, notamment comment ceux-ci restent plus ou moins présents au fil du temps. En outre, The 6 Days Struggle… porte un regard nuancé sur l’organisation du siège, puisqu’il souligne les nombreux divergences et les difficultés de prise d’une décision. Très vite, les contestataires sont divisé par ceux qui veulent rester et ceux qui désirent partir. Le regard des religieux, qui s’engagent à distance, sans participer dans les manifestations mais affirmant leur volonté de protéger les manifestants au sein de l’établissement religieux, est aussi très intéressant. Pas très loin de ce documentaire, la récente Assemblée de Mariana Otero, sur les Nuit Debout parisiennes de 2016, se dresse en miroir car marqué par des valeurs d’engagement nécessairement friables du fait de la difficulté d’un accord.
ITAEWON (이태원) – Ga-rem GANGYU
Section Paysage

Cette année fut particulièrement marquée par les portraits de femmes. Après Jamsil, Itaewon proposait, dans le registre du documentaire, une autre plongée spatio-temporelle et féminine. Le film de Ga-ren Gangyu est à la fois un portrait humain et urbain. Le quartier d’Itaewon à Séoul est un lieu cosmopolite, en raison de l’influence américaine instaurée après la guerre de Corée. Témoins de cette occupation, les nombreux bars à l’américaine, aujourd’hui rares, qui ont fleuri dans les années 1970. L’une des femmes interrogées tient justement le comptoir d’un de ces espaces uniquement fréquentés par des Occidentaux. Au rythme de la country, elle verse des bières aux quelques clients et évoque son ancien mari, Américain, disparu trop tôt dans sa vie. Le contraste est triste, entre cette femme fière de son bar et le vide de sa propriété, par ailleurs menacée par les dettes et la transformation urbaine. A quelques rues de là, un autre lieu en tout point semblable au sien vient justement de se faire racheter.

Les deux autres femmes ont aussi travaillé dans ces bars pour Américains. Leurs récits se mêlent mais force est de constater, malgré des tempéraments antithétiques, la mélancolie latente face aux désillusions amoureuses et aux difficultés de leur existence actuelle. Outre son triple portrait, Itaewon croque la force touristique, les festivités, et l’installation des jeunes artistes qui co-existent auprès de ces existences déchues. Parce qu’elle soumet son film à un rythme agréable, presque celui d’une ballade, la cinéaste a certaines difficultés à clôturer son documentaire. Les confidences ne sont jamais arrachées, mais surgissent au détour d’une ruelle, entre deux marchés d’artisan, au coin d’un bar délaissé. Ainsi, la troisième femme restera longuement mutique avant de laisser éclater sa colère face aux mauvais choix qu’elle a fait - partir aux Etats-Unis pour un an l’aura rendue malheureuse et ruinée - ou face à la paresse de son frère, qui refuse de s’occuper de sa petite nièce. Itaewon n’est pas seulement le visage d’un quartier dont la mutation laisse sur le bord beaucoup de ses anciens habitants, mais aussi le réveil en douceur des douleurs passées. Pour cela, le long-métrage de Ga-ren Gangyu est d’une remarquable pudeur.
MERRY CHRISTMAS MR MO (메리 크리스마스 미스터 모 ) – Dae-hyung LIM
Section Paysage

Dans ce premier long-métrage, le cinéaste peut surtout compter sur la force mélancolique de son magnifique acteur, Ju-bong Gi, un habitué de Hong Sang-soo que les festivaliers retrouvèrent aussi dans The First Lap. Le comédien campe un vieux barbier veuf et malade qui souhaite, avant son adieu au monde, réaliser son rêve de jeunesse : réaliser un film. C’est par ailleurs devenu le métier de son fils trentenaire, auprès duquel il réclame de l’aide, mais ce dernier, dépité par le milieu et les échecs, se lance dans le projet à reculons. Évidemment le mini-tournage sera l’occasion de se réconcilier.

La reconquête père / fils au travers de ce projet bricolé à la manière d’Ed Wood aurait pu émouvoir si le second se révélait un tant soit peu attachant. La fiancée du jeune cinéaste, par ailleurs longuement intermédiaire entre les deux hommes, est en comparaison un personnage beaucoup plus intéressant. En revanche, le parcours du vieux barbier émeut beaucoup, du fait de l’interprétation de Gi, mi-amer et mi-tendre. Si le film le montre d’abord comme un être solitaire et tristement marqué par le dépit, il inverse progressivement la situation. Car l’aîné se pose en observateur du monde qu’il va bientôt quitter. Il constate les solitudes des uns, les mauvaises attitudes des autres. Comme solution à la mélancolie ambiante, il offre son unique et ultime rôle au cinéma, celui d’un Chaplin à l’apathie Keatonienne. Le petit film muet burlesque qui clôture Merry Christmas Mr Mo procure le ravissement et rappelle la force de ce cinéma spontané et primitif : nous sortir et nous faire rêver hors du temps présent.
VANISHING TIME – Tae-hwa UHM
Section Paysage

Ce curieux film remporta tous les suffrages du Jury Sens Critique de cette année. Il n’est cependant guère difficile de comprendre d’où vient cet engouement : Vanishing Time s’inspire grandement des films de science-fiction américains, notamment ceux de Zemeckis et Spielberg. La référence, si elle n’est pas surprenante dans les productions venues d’Occident, est relativement nouvelle dans ce contexte sud-coréenne. En résulte un film hybride, entre le romantisme du film fantastique asiatique et la spontanéité des films pour enfants. Alors, comme pour un film américain, attention aux spoilers dans ce billet…

Quatre jeunes enfants partent en expédition dans la forêt et découvrent un étrange tunnel (comme dans Les Goonies). A l’intérieur, ils constatent d’étranges décors surnaturels, et remportent avec eux un oeuf scintillant (comme chez Spielberg ou Ridley Scott). La seule jeune fille du groupe retourne dans le tunnel récupérer un objet perdu. A son retour, ses trois camarades ont disparu. Quelques jours plus tard, un trentenaire l’aborde en secret et lui affirme qu’il est l’un de ses amis (comme dans Retour vers le futur). Le voyage temporel se lie à l’ambiance du film extraterrestre. L’origine de l’étrange oeuf capable de dissocier les strates temporelles ne sera jamais explicitée car seul compte, au final, la relation entre la fillette et son ami devenu trop adulte. Là surgit le romantisme ambiant, qui tend à isoler, de manière un peu trop exagérée, les enfants victoires de la vérité et les autorités méfiantes. Sur la seconde partie du film, le cinéaste se range résolument dans l’hypothèse fantastique, et met de côté l’aspect bien plus intéressant de l’enquête réelle et d’une probable ambiguïté quant au mensonge de l’adulte “revenu”. En revanche, la révélation de ce twist temporel, plutôt bien amené, constitue les meilleures scènes. lorsque le garçon raconte ses années dans un monde interrompu, la cinématographie, très inspirée, offre une pure balade onirique aux allures de conte de fée.
THE FIRST LAP – Dae-Hwan KIM
Section Paysage

Second long-métrage par un jeune cinéaste, ce film impressionne par la maturité de sa réflexion. Quoique un peu long et traînant dans ses développements, l’observation d’un couple trentenaire lambda dans la société coréenne d’aujourd’hui soulève beaucoup de questionnements quant à la génération actuelle, entre refus des valeurs anciennes et incapacité à se renouveler soi-même.

Outre Ju-bong Gi déjà présent dans Merry Christmas Mr Mo, le casting réunit plusieurs acteurs très fins dans leur restitution des dialogues : Hyun-Chul Cho et surtout Sae-Byuk Kim (déjà présente dans Jamsil et Le Jour d’après), jeune femme à fleur de peau malgré son regard apaisé. Ces deux derniers forment un couple tranquille, au quotidien confortable sans être trop aisé, L'absence d’ambition et presque la peur latente du changement frappent : l’un comme l’autre ne sont guère capable de sortir d’un état prolongé depuis plusieurs années, jusqu’à douter de La suspicion d’une grossesse, avouée à la première scène, met en quelque sorte le feu aux poudres. Mais ce n’est guère l’éclatement ou la confrontation violente : tous les espoirs, les déceptions et les désirs sont refoulés, noyés dans les longs voyages en voiture, les repas mangés docilement chez les beaux-parents, les déambulations au coeur des manifestations. La première scène en famille, chez les parents de la demoiselle, marque les esprits par sa finesse d’observation : chaque geste à table crie les reproches de l’un face à l’autre. La tension ne résout pas grand chose, mais elle permet de continuer à avancer. car les rares fois où les protagonistes se laissent aller aux explications, le problème ne fait que s’envenimer. Le cinéaste, par ce portrait glaçant des relations humaines, dresse un des aspects problématiques d’aujourd’hui, celui du refoulement des griefs, par peur de se retrouver isolé.
THE FORTRESS (남한산성) – Dong-Hyuk HWANG
Section Événements

Vrai film sur la stratégie, et non sur la guerre, The Fortress peut compter sur son casting impressionnant pour restituer la complexité d’une cour royale. Face à l’invasion de la dynastie Qing, le roi Injo se retranche dans sa forteresse enneigée. Il fait appel à ses nombreux conseillers afin de prendre une décision : négocier, ou déclarer la guerre ? Inspiré du roman homonyme de Kim Hoon, le film se révèle plus thriller de la parole que des enjeux belliqueux. Les scènes de combat sont rares, mais spectaculaires et cruellement violentes. Les coups éclatent, les lames tranchent, des têtes giclent, la neige se poudre de sang. En parallèle, le cinéaste montre d’autres violences tout aussi impressionnantes : tout d’abord, le froid et la faim qui rongent rapidement les populations à l’intérieur de la forteresse ; puis les joutes verbales au sein de la cour.

Ce jeu de paroles constitue le principal ressort de l’action de The Fortress. Pari osé car maintenu sur près de trois heures de film, et sans éviter les nombreuses courbettes, politesses, convenances et tournures subtiles d’un langage en apparence mesuré, mais capable d’engager un royaume tout entier vers la perdition. Entre chaque conseiller, la rivalité gronde en outre et les égos de chacun bataillent à l'ombre des gat, ces grands chapeaux noirs tissés. L’absurdité des échanges est souvent soulignée, car tout devient facilement prétexte à couper la tête de l’un ou de l’autre. Progressivement, la parole vient à se distribuer entre deux courtisans importants, mais diamétralement opposés : le duel de géants opéré entre Lee Byung-hun et Kim Yun-seok reste mémorable. Le premier incarne le stratège prudent et inquiet, sinistre dans ses comportements mais animé par un désir de salvation. Le second joue l’ancien fidèle refusant de croire en la perte du symbole royal, impitoyable dans sa quête de violence, mais paradoxalement sauveur d’une petite orpheline. Des portraits qui à la fois se contredisent mais partagent des points de ressemblance, et qui embrassent la même ambiguïté en temps de gouvernance, entre convictions personnelles et gestes palpitants d’humanité.
THE SEEDS OF VIOLENCE (폭력의 씨앗 ) – Tae-Gue LIM
Section Paysage
Face à ce premier film, le cinéma des frères Dardenne se convoque immédiatement à l'esprit. Même sens de la concentration sur un petit drame aux allures métaphoriques, portrait d'un jeune silencieux mais à la douleur expressive, repères spatio-temporels limités, révélations prudentes sur les agissements de chacun. Difficile de savoir si le jeune réalisateur connaissait le travail du tandem belge. La référence n’entame cependant point la qualité et la finesse de l’oeuvre, qui s’engage à dénoncer la violence sourde du service militaire en Corée.

Le soldat Tae-woo est en passe de finir son service, mais une dénonciation d’un abus de violence physique de sa part vient contrarier son départ sous les félicitations. Il cherche l’accusateur et en déduit que l’anonyme courrier vient d’un de ses deux cadets, Phillip ou Joo-yong. Le film va progressivement se concentrer sur le personnage de Joo-yong, d’abord vu comme un intermédiaire dans l’échange entre Tae-woo et Phillip. Le trio de départ va laisser place au duo, puis à la solitude de Joo-yong, que l’on devine peu à peu comme le dénonciateur des abus. Le maître mot, à tous les étages du trajet des jeunes hommes, est la dissimulation : la dénonciation n’est pas prise en compte afin de ne pas dénaturer l’image du service militaire, les échanges sur le sujet se font en pièces closes, portables éteints, les soldats doivent se taire, même s’ils savent, et surtout cet harcèlement physique ne doit pas apparaître. La perte d’une dent, qu’il faut à tout prix rafistoler en cachette, enclenche le second mouvement du récit, et glisse vers l’introspection personnelle de Joo-yong. Lee Ga-sub incarne ce dernier et offre une composition bouleversante, où le silence et la distance apparents laissent peu à peu transparaître la douleur refoulée - cousin, à des années de cela, d’Emilie Dequenne dans Rosetta.

Au-delà de son observation sans fard du service militaire, The Seeds of Violence dresse le microcosme des multiples jeux de rôles malmenant la société coréenne, et notamment une jeune population de plus en plus perdue par les moeurs. Au sein du cercle de soldats, tout semble feint, y compris la camaraderie autour d’un repas. Les règles imposées par la hiérarchie militaire dressent une façade derrière laquelle tout est permis. Explosent la virilité, le désir d’humilier l’autre, s’infiltre la peur constante d’échouer et d’être déclassé. le film terrifie encore plus lorsqu’il sort de la caserne et dévoile des comportements similaires dans la société qui avoisine Joo-yong. Le dernier plan prête en ce sens à controverse : certes, le geste du jeune homme traduit sa résignation et ne laisse pas espérer une révolte de sa part. Néanmoins la concentration du cadre et la sécheresse de la coupe au montage manifestent un vif besoin d’échapper aux carcans.
I CAN SPEAK (아이 캔 스피크) – Hyung-Seok KIM
Section Événements
Beau feel-good movie, porté par ses feel-good actors, I Can Speak est la belle surprise humaniste de cette 15ème édition. La projection fut en outre mémorable, dans une salle dynamisée par les jeunes populations coréennes de Paris. Si le réalisateur et le charmant Lee Je-Hoon (déjà fabuleux dans La Frappe) étaient présents, on pouvait regretter l’absence de la pétillante Na Moon-Hee.

I Can Speak suit le duo improbable formé par Min-jae (Lee Je-Hoon), un bureaucrate rigoureux devant élever seul son frère, et Ok-Boom (Na Moon-Hee), une vieille femme solitaire au sale caractère. Le début de la relation démarre sur un terrain volcanique, puisque le jeune homme, travaillant au service des plaintes civiles, tente de réfréner les élans de cette aînée passant son temps à dénoncer ses voisins. Le film joue d’abord la carte de la comédie de moeurs, avec un portrait très réjouissant des absurdités administratives. Puis, il montre l’évolution de la relation via des cours d’anglais. Le rapport est déjà amusant du fait de l’inversion hiérarchique usuelle : c’est le jeune qui devient le professeur du plus âgé. Comme les deux personnages partagent la même force caractérielle, le jeu d’apprentissage se met en place selon des moments de concurrence et des paris extrêmement drôles. Les deux acteurs s’en donnent à cœur joie et composent un tandem fort attachant.

Tout ceci aurait pu composer une charmante comédie si le film n’opérait pas un soudain virage à 180 degrés pour dévoiler la véritable raison de l’apprentissage de l’anglais pour Ok-Boom (de nouveau, attention aux spoilers). Car la vieille dame prend des cours d’anglais dans l’espoir de témoigner à la cour internationale et de lever le voile sur la violence qu’elle a subie étant jeune. Cette violence, c’est celle qui a touché les “femmes de réconfort” durant la Seconde Guerre Mondiale, soit ces prisonnières violées et torturées par l’armée japonaise. I Can Speak s’engage dans un second temps dans le combat historique et judiciaire et s’inspire de récents témoignages de femmes victimes dans ses scènes de procès. Pour Ok-Boom, maîtriser l’anglais, cette langue devenue le passeport international, agit comme un moyen de libérer autrement la parole, une parole qui se retrouve ficelée en coréen. Le basculement vers le mélodrame et le film de procès ne constitue cependant pas une rupture violente dans le récit. La réalisation très enlevée de Hyung-Seok Kim glisse entre les genres, et s’amuse follement à user des différents styles de comique, parodier sur certains plans les codes de l’horreur ou du thriller, dresser un portrait joyeux, mais néanmoins réaliste, de la vie de quartier et de ses affrontements de classe. Habilement, le film multiplie les pistes et les petites subversions afin de peu à peu déboucher sur un sujet plus grave - et malheureusement encore très tabou. I Can Speak a su trouver le ton juste entre le divertissement et la réflexion, en somme ce que l’on désire de tout film au cinéma. Il peut dresser une peinture universelle où peut vibrer la vérité personnelle.
JANE (꿈의 제인) – Hyun-Hoon CHO
Section Portrait
Comme l’année dernière, où les festivaliers avaient pu découvrir le solaire The World of Us de Ga-Eun Yoon, le FFCP fit le bon choix de convier le jeune cinéaste Hyun-Hoon Cho et son envoûtant Jane. Dans cet étrange parcours initiatique, l’adolescente So-Hyun (Lee Min-Ji) est une fille sans famille, passant de groupes en foyers. Elle est notamment accepté par Jung-ho, un garçon de bar plus âgé qu’elle. Mais celui-ci disparaît. So-hyun va alors faire la découverte de la douce et romantique Jane (Kyo Gyo-Hwan), un travesti aussi à la recherche de la même personne qu’elle.

La définition du récit se révèle difficile. Car l’histoire de Jane, passée une première demie-heure plutôt linéaire, joue des effets de ressac, de répétition troubles, de repères spatio-temporels brouillés. Le film, par son image vaporeuse et ce flou entretenu entre chimères et réalité, peut rappeler le Virgin Suicides de Sofia Coppola. Mais il y a dans la réalisation de Hyun-Hoon Cho une invitation au voyage plus exotique - à maintes reprises on s’écarte de la ville et on s’engage dans ces sentiers vierges et inhabités, en marge d’une société sourde aux tourments de ces jeunes - ainsi qu’un attachement plus humain à son héroïne. Nous ne sommes pas dans le regard parfois entomologique de Coppola sur ses belles créatures, mais dans un portrait attentif et sensible d’une gamine très paumée, qui absorbe au fil de ses étapes les différents effets de violence de sa génération.

Remarquablement, le film trouve un fin équilibre entre les élans fantastiques, l’étrangeté hypnotique de sa lumière et de ses espaces, sans s’y abandonner toutefois ; et la réalité amère et sournoise de la ville sud-coréenne. Car Hyun-Hoon Cho fait aussi la peinture d’un phénomène de société contemporain à son pays : la fugue de nombreux jeunes loin de leurs familles et qui vont se réunir à plusieurs dans des appartements. Le paradoxe, ou le retournement de situation tragique, est que ces groupes reproduisent vite le modèle d’une famille traditionnel : le garçon le plus âgé et le plus autoritaire se fait appeler “père” par les autres, gère les dépenses de tout le monde, et orchestre divers trafics sous son autorité. La vision, reconstituée d’après les enquêtes du cinéaste et les témoignages qu’il a pu réunir, terrifie car elle montre les mécanismes d’une reproduction abusive de systèmes familiaux déjà existants. En outre, la qualité elliptique du film permet d’approcher le thème sans sensationnalisme ni complaisance : elle laisse au contraire agir des zones d’ombre et une lourde ambiguïté quant à la réalité des agissements mis en place dans ces groupes.

Le ressac s’impose peu à peu comme principe constructeur du film. En réalité, Jane surprend par le minutieux redéploiement de ses éléments. Des personnages comme des tragédies reviennent. A chaque fois, la jeune fille paraît revivre les mêmes instants, redémarrer les mêmes moments - pourtant sa lente évolution s’inscrit en creux de cette sensation de re-vécu. Se perd-t-elle entre ces nombreuses “familles” et tragédies qu’elle traverse, ou se perd-t-elle parmi ses souvenirs et ses sensations ? Bien que rarement à l’écran, la Jane qu’elle rencontre au début du film s’impose comme la terre d’accueil déjà nostalgique d’un temps lointain. Un protagoniste certes fort différent, mais dont la mélancolie fait écho au mal-être de l’adolescente, et dont la tendresse nonchalante offre un havre de paix au sein d’une maison bien entretenue. Le film de Hyun-Hoon Cho doit beaucoup à la complétude de ses deux acteurs. D’un côté, la très jeune Lee Min-Ji et sa touchante expressivité sous sa silhouette gauche et un peu ronde. De l’autre, la sensualité pleine de malice de Kyo Gyo-Hwan, qui confère à ce personnage de travesti des comportements très maternels, mais aussi enfantins. Pris dans son principe de l’éternel retour, le film offre la possibilité à ces personnages de se retrouver. possibilité rêvée, fantasmée ? Peut-être, mais le long regard complice échangé entre la jeune fille et l’adulte maquillé, à travers les paillettes d’une fête, n’en finit pas de bouleverser. Regard dépassant les tragédies, proche de celui d’une mère et de sa fille, ou d’un frère et de sa soeur, regard familial et résistant.
Commentaires
Bonjour Oriane, tu as dû te régaler en effet en voyant tous ces films qui j'espère seront distribué dans plusieurs salles. Même si j'habite Paris, à moins de prendre des jours de congés, je ne peux pas assister à ce genre d'événements, je le regrette. J'en profite pour te souhaiter un bon réveillon du Nouvel An et une très belle année 2018 un peu en avance.