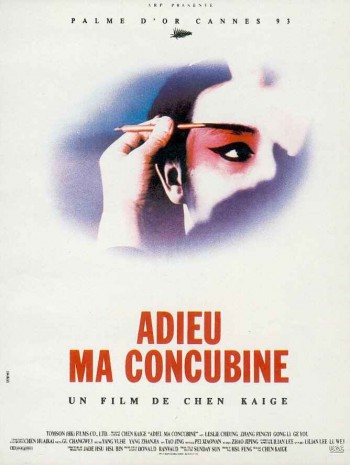Suis-moi je te fuis / Fuis-moi je te suis
Le Conte de la princesse Kaguya
Briser la croissance
LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA (KAGUYA-HIME NO MONOGATARI) – Isao Takahata

Au milieu du film, la jeune princesse Kaguya, tandis que résonne les tambours de la fête en son honneurs, mais à laquelle elle n'est pas conviée, entend les éclats d'une conversation à son sujet. En quelques phrases surgissent la moquerie et l'insistance sauvage d'une poignée d'hommes. D'emblée, le cadre se transforme, l'animation bascule dans un état de folie, de rage et de désespoir foudroyant : la princesse fuit, ses larmes coulant à la cadence de ses cheveux fouettant le vent. La cruauté de son destin s'imprime en traits rageurs et puissants sur la pellicule, et cette soudaine expérimentation graphique compose en quelques plans l'une des plus vibrantes scènes de course dans l'animation.

Tout le film de Takahata tire sa force dans ce simple exemple : de scènes en scènes, d'événements en événements, au fil de la croissance fantastique de la jeune fille cueillie au creux d'un bambou, se bâtit une esthétique de l'épure et de l'estampe, brisée par de fulgurants bouleversements graphiques. De même, le récit, bien plus lisible et limpide dans son déroulement, subit des bouleversements par à-coups, de brefs virages d'un ton à l'autre, de délicieux moments de dérive... Ce sont ces actions de déséquilibres et d'expérimentations momentanées dans un univers très construit qui composent peu à peu l'émotion de Kaguya-Hime.

Takahata cristallise tout son génie du détail et de sa sensibilité du quotidien pour embrasser ce conte célèbre. La précision du récit de cette jeune Princesse et sa maturation par étapes dans le monde des vivants contiennent les tendances expérimentales de Takahata tout en lui offrant ses plus belles opportunités poétiques et fantaisistes. Jamais la croissance exceptionnelle du bébé Kaguya n'a été aussi émouvante, prise dans des rondeurs évolutives ou des gonflements du trait et des membres, jamais le surgissement des étoffes depuis le bambou n'a paru aussi magique dans son chatoiement des couleurs, jamais les envolées furieuses de la Princesse n'ont paru aussi bouleversantes. Mais Takahata n'oublie jamais, dans ce récit improbable, ce qui lui tient à cœur, c'est à dire la mélodie du quotidien, la sensibilité d'une vie paisible et reposée.

À ce niveau, la nature et la vie dans les montagnes rejoignent la simplicité fraîche de Souvenirs goutte-à-goutte. L'existence paysanne et épicurienne dont profite Kaguya sur ses premières années est un songe en écho aux récoltes du Benibana, ou encore aux balades de Goshu le petit violoncelliste. La croissance de la princesse s'égrène à la manière d'un livre d'images, parcouru de détails bucoliques, de drames quotidiens et de plaisirs épicuriens. La dégustation d'un melon sous les buissons devient anthologie, les premiers pas d'un bébé sous les branches provoque une envolée... Plus loin, le film de Takahata renoue avec son amour de l'esquisse, de l'haïkus et de la vivacité expressive : son trait et sa légèreté dans la couleur, souvent pâle et diluée, rejoignent les croquis d'Hokusai ou de Keisai. Du premier, il retient la découpe franche, la finesse du pinceau et des incrustations de détails, du second, il explore le voluptueux sens de la courbe. Ces influences jaillissent sur la seconde partie, qui laissent partager l'arrivée de la princesse à la ville, peuplé de personnages semblant issus d'estampes, qui s'animent comme des fantômes picturaux. La forme de Takahata gagne alors en grâce, en symboles comiques, en déhanchements amusants.

Mais Kaguya-Hime n'est enfin pas simple testament des passions et des expressions du cinéaste : il déploie son histoire, ce sentiment de désillusion tragique qui envahit peu à peu le jeune princesse. Progressivement, le film compose, par l'entremise de cette campagne paradisiaque, une émotion de la nostalgie, et fait émerger dans la fraîcheur de son personnage l'angoisse de la perte de l'enfance. À ce niveau, la séquence sous les cerisiers déploie non pas la joie de vivre de la jeunesse, mais bien plus le mince espoir retrouvé du goût du passé. D'un plan à l'autre, les cheveux – si métaphoriques dans leur retranscription du sentiment – dansent sous les pétales avant d'échouer, déçus, sur les épaules de Kaguya s'apercevant de la distance qui la sépare de ce monde végétal et paysan. Le récit de ce dernier film de Takahata devient alors celui de ce déchirement de l'enfance et d'une jeune fille à la croissance à jamais brisée.