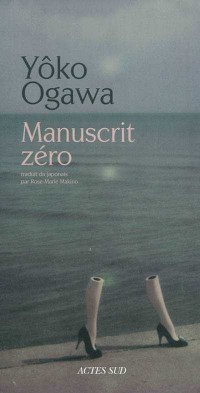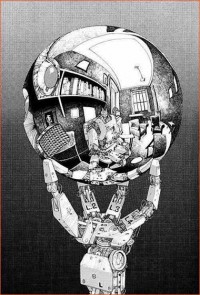Ruptures et libération
HANA-BI (1997) – Takeshi Kitano

Le cinéma de Kitano est un cinéma fait de ruptures, et Hana-Bi en est le film le plus probant. Que deviennent les personnages une fois qu'on leur a arraché, une à une, toutes les raisons de vivre ? C'est la question qui transparaissait à travers le couple de Dolls, les « mendiants enchaînés » marchant incessamment dans les parcs. Dolls se fait lui-même l'écho d'Hana-Bi, qui joue sur la même fragmentation spatio-temporelle et le même suivi des personnages. Mais là où Dolls restait teinté d'un certain romantisme (par exemple avec l'histoire de la vieille fiancée attendant sur le banc), Hana-Bi s'avère plus sec, plus désespéré, et paradoxalement, à l'image de son titre qui signifie « feux d'artifice » plus éclatant et lyrique. Primé du Lion d'or à Venise en 1997, Hana-Bi reste à ce jour l'un des chefs d'oeuvre dans la filmographie de Kitano.

Le film débute sur de paisibles plans d'ensemble du paysage et de la mer, harmonieusement accompagné de la musique poignante de Joe Hisaishi (beaucoup sont d'accord pour affirmer que la bande originale d'Hana-Bi est bien l'une meilleures compositions de Joe Hisaishi). Le lyrisme de la musique et le calme des plans sont brusquement coupés, au montage, par l'arrivée du personnage interprété par Takeshi Kitano, policier sur sa fin de vie, impuissant face à la maladie de sa femme. Tout le film semble ainsi se composer sur une série de ruptures : rupture psychologique de la femme de Kitano, retournée à un état d'enfance ; rupture des jambes de son collègue, paralysé à la suite d'une intervention ayant mal tournée ; rupture dans les relations avec les gangs mafieux. Cette permanence de la rupture est à lier avec le terrible accident de moto qu'a subi Kitano et qui lui a infligé de graves séquelles physiques. Mais, au-delà de cet expérience personnel, une grande partie de l'oeuvre du cinéaste japonais se concentre sur cette question de la survie : que restent-ils aux protagonistes les plus démunis ? A l'instar de Ozu, qui dépeignait surtout les chutes et ruptures sociales et familiales de ses personnages (observations reprises par Hirokazu Kore-eda , qui prolonge aujourd'hui l'oeuvre du grand maître), Kitano se concentre sur les désoeuvrés, les mutilés, les malades, les fous, le protagoniste qu'il interprète tombant au fur et à mesure dans l'aliénation. Une première partie du film dépeint la condition de ces personnages et tend, par fragmentation, à décrire les raisons de ces différentes déchéances. Dans un second temps, le plus magistral dans Hana-bi, Kitano dépasse le contexte et suit la fin de ses protagonistes dans des chemins de croix bien souvent déchirants.

Le regard artistique de Kitano s'exerce alors de manière très forte dans ce film, conférant à la réalisation une puissance graphique extraordinaire. De fortes lignes parallèles sur les plans de route soulignent le rapport au chemin, au destin, chemin dont finissent par dévier les personnages. Le film privilégie les plans d'ensemble et les vues en plongée, encadrant et isolant ces différents destins dans de larges espaces. Une large et fondamentale place est cédée à la mer, endroit où s'isole le peintre handicapé, mais également les personnages de Kitano et de sa femme à la fin du film. La mer inspire un fort sentiment de lyrisme tout au long du film, ultime étape avant la fin, généralement accompagnée de la musique élégiaque et bouleversante de Joe Hisaishi. La place du graphisme et de la peinture se retrouve aussi dans les tableaux en début de générique et échelonnant tout le récit, par le biais du personnage du peintre (un des miroirs de Kitano, cependant). Ces tableaux jouent eux aussi sur un contraste entre lyrisme et violence, passant par une série de symboles : les fleurs, à l'image de la fleur de l'affiche, représentent bien souvent l'épanouissement amoureux, la plupart des personnages ayant perdu ceux qu'ils aimaient et se retrouvant isolés, sans sentiments ni sexualité ; mais également l'abondance des silhouettes, telle celles de la famille réunie, toujours symbolisant le bonheur perdu ; et enfin la présence de la mer, très nostalgique. Les choix artistiques dans ces tableaux équivalent à des vues très frontales, sans relief ni recherche de perspective, en exact opposition avec la cinématographie du film, comme si le cinéma permettait une plus grande distance avec les récits dépeints, tandis que les peintures s'affiche comme le constat creux et désespéré de la vie du peintre. Ainsi, le personnage crée cette magnifique toile désertique aux multiples touches de couleur blanche, par écho à la vanité de son existence.

La composition, pour reprendre ce terme propre à la peinture, s'avère s'inscrire dans le rapport à la spirale. Le montage, effectué par Kitano lui-même, s'articule selon l'idée de la fragmentation et de la réminiscence, là où le cinéma japonais affirme l'importance d'une temporalité cyclique, où le souvenir persiste. Les fragments d'images obsessionnelles, comme celles au ralenti de l'intervention violente des policiers, s'intercalent dans la narration, brisant la continuité et reconstituant les espaces mentaux des différents protagonistes. autant au niveau de la temporalité, qu'au niveau visuel ou sonore. Le film alterne avec les moments de tendresse et de violence, contrastes propres au style du cinéaste : une émouvante scène nous montre la complicité de Kitano nouée avec la femme malade autour d'un jeu pour enfants ; tandis que dans d'autres, l'ancien policier enfonce des baguettes dans le visage d'un mafieux, ou effectue un braquage de banque avec la plus grande froideur possible. La succession des événements est toujours filmé avec une certaine distance, sans jugement, et avec un sens efficace de la suggestion et des jeux de regards. Kitano, dans les séquences de violence, se cache ainsi derrière ses lunettes noirs, rendant impossible à saisir son regard donc neutralisant toutes émotions. La neutralité est par ailleurs un point essentiel, car la gravité des événements font que le personnage se retrouve presque dénué de sentiments, d'âme, d'humanité.

Enfin, le rapport au titre, Hana-bi (« feux d'artifice » en japonais, et le caractère « hana » signifie fleur) s'inscrit dans cette spirale de violence, où « l'explosion » des feux d'artifice se traduit dans « l'implosion » des sentiments à l'intérieur des corps en apparence neutres. Pas d'explosion physique chez Kitano, puisque cette explosion folle est libérée par le biais de la musique, des actes (notamment l'acte final), de la pression psychologique, de la beauté renversante de ce film.